Sur la situation déplorable de la ville d’Antioche
Deuxième homélie sur les statues — au peuple d’Antioche
Nos calamités, quoique trop réelles, ont quelque chose d’étrange et d’incroyable. Sans que l’ennemi nous poursuive, nous fuyons ; sans avoir livré de combat, nous abandonnons notre pays, comme si nous étions emmenés en captivité ; sans avoir soutenu les assauts des barbares, sans avoir vu la face de l’ennemi, nous éprouvons les mêmes maux que les captifs d’un vainqueur superbe. Tous les peuples voisins apprennent maintenant nos disgrâces nos citoyens fugitifs qui sont reçus dans leurs murs, les instruisent du coup funeste qui vient de nous être porté.

Mais le bruit que notre calamité fait dans le monde ne m’afflige pas, je n’en rougis pas. Ah ! que toutes les villes voisines apprennent les malheurs de notre cité, afin que, partageant l’affliction de cette métropole, elles élèvent de concert leurs voix vers le Souverain des cieux, et que toutes d’un commun accord lui demandent le salut de leur mère commune. Antioche, il n’y a pas longtemps, a été agitée par un tremblement de terre ; aujourd’hui les cœurs de ses citoyens sont livrés à de violentes inquiétudes : alors c’étaient les fondements des maisons qui étaient ébranlés ; aujourd’hui ce sont les âmes des habitants que secoue une commotion terrible. La mort se présente chaque jour à nos yeux : nous vivons dans de continuelles terreurs ; et plus misérables que des criminels qui attendent dans la prison l’exécution de leur sentence, nous éprouvons dans toute sa rigueur le supplice du fratricide Caïn.
Le siège que nous essuyons est d’un genre tout à fait nouveau, il est bien plus cruel que les sièges ordinaires : ceux qui sont investis par l’ennemi, renfermés dans leurs murs, ne sont exclus que des dehors de leur ville. Pour nous, renfermés chacun dans l’intérieur de nos maisons, nous n’osons pas même nous montrer dans la place publique ; et comme des assiégés ne peuvent impunément sortir de leurs remparts par la crainte des ennemis qui les environnent, de même le plus grand nombre de nos citoyens ne peuvent sortir impunément, ni paraître en public, parce qu’ils redoutent ces hommes qui de tous côtés observent les innocents comme les coupables, les enlèvent du milieu de la place, et traînent tout le monde ! sans distinction devant les tribunaux. Aussi les personnes libres sont-elles retenues et comme enchaînées au fond de leurs demeures avec leurs esclaves : Qui a été arrêté aujourd’hui ? qui a été traîné en prison ? qui a subi le supplice ? demandent-elles sans cesse avec inquiétude, désirant d’apprendre ces nouvelles, dans le plus grand détail, de la bouche de ceux par qui elles peuvent être instruites sans danger, obligées chaque jour de déplorer les malheurs d’autrui, tremblant pour elles-mêmes, mourant à chaque instant de frayeur, et plus malheureuses que si elles étaient mortes réellement.
Celui qui par hasard se trouve à l’abri de ces craintes et de ces alarmes, veut-il se rendre dans la place publique, les tristes objets qu’il y rencontre le forcent bientôt de rentrer dans sa maison. Un ou deux hommes qui, la tête baissée, marchent d’un air morne et taciturne, voilà tout ce qu’il aperçoit dans ce même lieu où peu de jours auparavant les citoyens se rassemblaient en foule comme les flots de la mer. Toute cette multitude est maintenant disparue ; et de même qu’une vaste campagne dépouillée du plus grand nombre de ses arbres, n’offre plus qu’un spectacle aussi déplaisant qu’une tête qui a perdu la plus grande partie de sa chevelure : ainsi le sol de notre ville dont la plupart des habitants se sont enfuis, et où l’on ne voit plus que quelques hommes épars, est devenu un objet pénible à voir et qui répand sur les yeux du spectateur comme un nuage de tristesse. La terre que nous habitons, le ciel même, semble avoir changé pour nous de nature, et le soleil ne paraît plus briller de son éclat ordinaire. Non que les éléments ne soient plus les mêmes, mais nos yeux obscurcis par la douleur ne sont plus disposés de même pour recevoir l’éclat des rayons qui les frappent. Ainsi nous voyons s’accomplir ce que disait autrefois un prophète dans ses lamentations : Le soleil se couchera pour eux en plein midi, et le jour sera converti en ténèbres. (Amos, VIII, 9.) Ce n’est pas que l’astre qui nous éclaire se cachât, ni que le jour disparût ; mais, des hommes plongés dans l’affliction ne pouvaient voir, même en plein midi, la lumière, que la tristesse, comme un nuage épais, dérobait à leurs regards ; et telle est notre situation actuelle. De quelque côté que nous tournions les yeux, soit que nous les jetions sur le sol de la ville, sur ses murs, sur ses colonnes ; soit que nous les promenions sur les objets d’alentour, nous ne croyons plus voir qu’une nuit affreuse, une obscurité profonde tant la plus extrême consternation règne et domine partout ! Un morne silence, une solitude pleine d’horreur, ont remplacé l’agréable tumulte d’une multitude en mouvement ; et comme si tous les citoyens avaient été ensevelis sous terre, ou changés en statues de pierre, toute la ville maintenant muette, toutes les langues comme enchaînées par le malheur qui nous opprime, présentent partout le calme triste, morne et lugubre que laissent après elles les dévastations d’un ennemi dont le fer et la flamme ont tout ravagé et tout consumé. C’est bien aujourd’hui qu’on peut s’écrier avec le Prophète : Appelez les femmes qui pleurent dans les funérailles ; faites venir les plus habiles. (Jér. IX, 17.) Que tous les yeux, comme des fontaines, s’ouvrent pour verser des larmes en abondance. Collines, affligez-vous ; lamentez-vous, montagnes. Invitons toutes les créatures à prendre part à nos disgrâces. Une ville puissante, la capitale de tout l’Orient, est peut-être à la veille d’être effacée de dessus la terre. Celle qui comptait dans son sein un nombre infini d’enfants, a perdu tout à coup ses enfants, et se voit entièrement délaissée. Eh ! qui pourrait la secourir dans ses maux ? Celui que nous avons outragé n’a point d’égal en ce monde ; c’est l’Empereur élevé au-dessus de tous les hommes, le chef de tous les mortels. Recourons donc au Souverain des cieux, et implorons son assistance. Non, si le secours d’en-haut nous manque, notre malheur est sans remède.
Sur l’angoisse des habitants d’Antioche
Treizième homélie sur les statues — au peuple d’Antioche

Effrayés par les supplices dont on les menaçait, la plus grande partie des citoyens s’étaient retirés dans les déserts, dans le fond des vallées, dans les lieux les plus obscurs et les plus inconnus ; chassées de tout côté par l’épouvante, les femmes fuyaient les maisons, les hommes la place publique, et l’on voyait à peine une ou deux personnes marcher ensemble, la mort peinte sur le visage. Nous nous transportâmes donc au prétoire pour voir les suites de cette malheureuse affaire ; et là, à la vue des restes de la ville rassemblés, ce prétoire, lieu où s’assemblaient les juges pour rendre la justice (60) qui nous étonnait davantage, c’est qu’au milieu de cette multitude qui assiégeait les portes, il régnait un morne et profond silence comme dans une solitude parfaite : tous se regardaient les uns les autres, et chacun, sans oser interroger son voisin ni répondre à ses questions, se tenait en garde et dans fa défiance, parce qu’il en avait déjà vu plusieurs enlevés tout à coup de la place publique, et traînés dans les prisons. Ainsi tous en commun nous portions nos regards au ciel, nous élevions nos mains en silence, attendant notre secours d’en-haut, invoquant le Seigneur, le conjurant d’assister les malheureux qui allaient subir un jugement, d’adoucir le cœur des juges, de les porter à rendre une sentence favorable. Et comme ceux qui des bords de la mer aperçoivent des infortunés qui font naufrage, séparés d’eux par un vaste océan, hors d’état de les joindre, de leur présenter une main secourable, de les arracher au péril qui les menace, leur tendent les bras de dessus le rivage, versent des larmes, supplient Dieu de les assister au milieu de la tempête : de même, nous, sans pouvoir proférer une parole, nous invoquions en esprit le Très-Haut, nous le conjurions de présenter la main aux malheureux qui allaient paraître au tribunal, comme s’ils eussent été jetés au milieu des flots, de ne pas permettre qu’ils fussent engloutis et que la sentence des juges leur fît essuyer un triste naufrage.
Voilà ce qui se passait devant les portes du prétoire.
Pénétrant plus avant dans les cours, nous apercevions un spectacle plus effrayant encore ; des troupes de soldats armés de piques et d’épées, étaient placées en cet endroit pour donner toute sûreté aux juges renfermés dans les salles. Tous les parents des accusés, leurs, femmes, leurs mères, leurs filles, leurs pères, se tenaient aux portes du tribunal : or, dans la crainte que si les accusés étaient traînés au supplice, leurs parents hors d’eux-mêmes et ne pouvant tenir contre un pareil spectacle, n’excitassent quelque trouble et quelque tumulte, les soldats les intimidaient pour les écarter, et jetaient d’avance la frayeur dans leur âme. Mais ce qu’il y avait de plus touchant, on voyait la mère et la sueur d’un des infortunés qui attendaient leur sentence, couchées aux portes de la salle où étaient les juges, se rouler par terre à la vue de tous les assistants, le visage voilé, et pénétrées de honte, autant du moins que l’excès du malheur laissait de place à ce sentiment dans leurs âmes. Sans être accompagnées de personne, sans amie ni suivante, seules au milieu de tant de soldats, dans l’extérieur le plus simple et le plus négligé, elles se traînaient aux portes du tribunal plus affligées et plus souffrantes que ceux mêmes qui subissaient le jugement, entendant les paroles des bourreaux, les coups de verges, les gémissements des misérables `sur lesquels ils tombaient, et ressentant à chaque coup de plus cruelles douleurs que ceux mêmes qui étaient frappés. En effet, comme la preuve des charges dépendait de la déposition des esclaves mis à la torture, lorsqu’elles entendaient les coups de verges dont on frappait quelque malheureux pour lui faire déclarer les coupables, lorsqu’elles entendaient ses gémissements, elles levaient les yeux au ciel, elles conjuraient le Très-Haut de lui donner le courage et la patience, elles tremblaient que n’ayant pas la force de supporter les tourments, il ne se trouvât comme dans la nécessité de dénoncer leurs parents et de les perdre ; enfin elles étaient dans l’état de navigateurs battus par les flots. Lorsque ceux-ci aperçoivent de loin une vague qui s’élève, qui s’enfle par degrés, et qui menace d’engloutir leur navire, ils sont morts d’épouvante avant qu’elle ne soit venue crever sur eux : de même ces malheureuses femmes, à chaque parole, à chaque gémissement qu’elles entendaient, tremblant que les esclaves vaincus par les douleurs de la torture ne fussent forcés de déclarer un de leurs proches, s’alarmaient et se représentaient mille morts. Il y avait tourments au dedans du tribunal, et tourments au dehors. D’une part c’étaient les bourreaux qui torturaient, de l’autre c’était le sentiment impérieux de la nature et sa sympathie puissante qui mettait à la gêne le cœur d’une mère et d’une sueur. Les lamentations des accusés et celles de leurs proches se faisaient entendre également. Les juges eux-mêmes gémissaient au fond de leur âme, affligés de se voir contraints de présider à cette scène douloureuse.
Moi, qui étais présent, qui voyais des mères et leurs filles, auxquelles leur sexe et leur condition imposaient une retraite sévère, paraître alors, aux yeux des hommes ; qui voyais étendues sur la poussière des personnes accoutumées à reposer sur le duvet ; qui enfin voyais des femmes environnées dans leurs maisons d’esclaves et de suivantes attentives à les servir, entourées du faste de l’opulence, dépouillées maintenant de tout cet appareil, se traîner aux pieds des assistants, implorer leur compassion, supplier chacun d’eux de protéger pour sa part et de défendre leurs parents qu’on allait juger : témoin de ce spectacle lugubre, je m’écriais avec l’Ecclésiaste : Vanité des vanités, et tout n’est que vanité. (Eccl. XII, 8.) Je sentais que cette autre parole n’était que trop confirmée par ce qui se passait sous nos yeux : Toute la gloire de l’homme est comme la fleur des champs ; l’herbe sèche, et la fleur tombe. (Is. XL, 6, et 17.) Alors sans doute les richesses, la naissance, les titres, les amis, tous les autres avantages s’évanouissaient, devenaient inutiles par l’attentat dont on poursuivait la punition. Et comme un oiseau dont on a enlevé les petits, lorsqu’il ne retrouve plus à son retour la tendre famille à laquelle il apportait la nourriture accoutumée, encore qu’il ne puisse l’arracher des mains d’un chasseur cruel, vole cependant autour de lui, et témoigne par là toute sa douleur : de même les femmes dont les fils enlevés de leurs bras dans leurs maisons, étaient tenus renfermés, comme pris dans un filet et dans un piège, ces malheureuses mères séparées de leurs enfants qu’elles ne pouvaient joindre, qu’elles ne pouvaient arracher des mains des satellites, montraient du moins toute leur affliction en s’efforçant d’approcher, en se roulant aux portes du tribunal, en gémissant et en se lamentant. Frappé de ce spectacle, je pensais au jugement dernier, à ce jugement terrible, et je me disais à moi-même : Si une mère, une sœur, un père, si nul autre, quelque innocent qu’il puisse être, ne peut soustraire des accusés à leurs juges qui ne sont que des hommes, qui pourra nous secourir dans le jugement redoutable de Jésus-Christ ? qui osera dire un mot en notre faveur ? qui entreprendra de dérober des coupables aux supplices éternels auxquels ils seront condamnés ? Toutefois c’étaient les premiers à la ville, les principaux de la noblesse qui étaient alors jugés ; et ils se seraient trouvés trop heureux si, dépouillés de leur fortune et de la liberté même, on leur eût permis seulement de vivre.
Les effets salutaires de la crainte qu’ils éprouvent
Quinzième homélie sur les statues — au peuple d’Antioche

Où est la crainte, là ne se trouve pas l’envie ; où est la crainte, l’amour des richesses ne vient pas troubler l’âme ; où est la crainte, la colère s’apaise, les mauvais désirs sont réprimés, les passions déréglées sont bannies ; et de même que, lorsqu’une maison est gardée sans cesse par une troupe de soldats, ni brigand, ni assassin, ni aucun autre malfaiteur n’ose en approcher : ainsi, lorsque la crainte s’empare de nos âmes, aucune passion déshonnête n’y entre facilement, toutes s’enfuient et se retirent, chassées de tous côtés par la force impérieuse d’une frayeur salutaire ; et ce n’est pas le seul avantage qu’elle nous procure, nous en recueillons un bien plus grand fruit encore. Non seulement elle chasse de notre cœur les passions criminelles, elle y introduit même toutes les vertus avec une extrême facilité. Où est la crainte, là se trouvent l’empressement à faire l’aumône, la ferveur de la prière, les larmes sincères et abondantes, les gémissements pleins de componction. Non, rien ne consume davantage les péchés, rien ne fait plus accroître et fleurir la vertu que le sentiment d’une crainte continuelle : aussi est-on également éloigné, et de faire le bien lorsqu’on n’éprouve pas ce sentiment, et de faire le mal lorsqu’on l’éprouve.
Ne nous attristons donc pas aujourd’hui, ne nous laissons pas abattre par l’affliction présente, mais admirons les conseils de la sagesse divine, de cette sagesse qui a relevé et rétabli notre ville par les moyens mêmes dont le démon s’était servi pour la renverser. Le démon avait inspiré à quelques hommes pervers le projet d’outrager les statues de nos princes, afin que notre ville fût ruinée de fond en comble. Dieu a fait servir cet événement même à notre avancement dans le bien, il en a usé pour nous tirer de notre assoupissement par la crainte de la peine dont nous sommes menacés ; et les artifices mêmes du démon ont produit le contraire de ce que voulait cet esprit de malice. Notre ville se purifie de jour en jour, les carrefours, les rues et les places n’offrent plus de femmes débauchées, ne retentissent plus de chansons obscènes. De quelque côté que l’on porte ses regards, on ne voit partout que des larmes salutaires au lieu de ris immodérés, on n’entend que des paroles de bénédiction et de sagesse au lieu de paroles libres et déshonnêtes. Toute la ville semble être devenue une église.
Les boutiques sont fermées comme dans un jour de fête, on accourt à l’envi dans nos temples, on y passe les journées entières à prier, et tous les habitants, d’une commune voix, invoquent le Très-Haut avec la plus grande ferveur. Quel discours, quelle exhortation eût pu produire cet effet ? Quel espace de temps eût pu amener ce changement heureux ? Ainsi, rendons grâces au ciel de l’événement qui nous fait gémir ; ne nous affligeons pas, ne nous désolons pas. Il est donc prouvé par ce que je viens de dire que la crainte est un bien.

Saint Jean Chrysostome – Homélie sur les statues — au peuple d’Antioche
Œuvres complètes, traduites pour la première fois sous la direction de M. Jeannin, licencié ès-lettres professeur de rhétorique au collège de l’Immaculée-Conception de Saint-Dizier.
Bar-le-Duc, L. Guérin & Cie, éditeurs, 1864, TOMES II et III


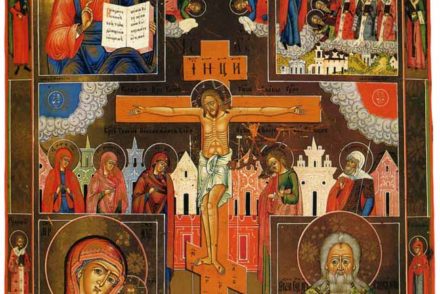

Pas de commentaire