B. Manifestations physiques de l’expérience « charismatique »
L’une des réactions les plus courantes à l’expérience du « Baptême du Saint-Esprit » est le rire. Un catholique témoigne : « J’étais si joyeux que tout ce que je pouvais faire était de rire en m’allongeant par terre » 1.

L’Annonciation, Novgorod, seconde moitié du XVIe siècle. Detail
Un autre catholique : « Le sentiment de la présence et de l’amour de Dieu était si fort que je me souviens d’être assis dans la chapelle pendant une demi-heure juste en riant de joie à cause de l’amour de Dieu » 2. Un protestant témoigne que lors de son « baptême » « j’ai commencé à rire… Je voulais juste rire et rire encore comme vous le faites lorsque vous vous sentez si bien que vous ne pouvez tout simplement pas en parler. J’ai tenu mes côtes et j’ai ri jusqu’à ce que je sois plié en deux » 3. Un autre protestant : « La nouvelle langue qui m’a été donnée était mêlée de vagues de joie dans lesquelles chaque peur que je venais de ressentir semblait s’éloigner. C’était une langue de rire » 4. Un prêtre orthodoxe, le p. Eusebius Stephanou, écrit : « Je ne pouvais cacher le large sourire sur mon visage qui pouvait se transformer en rire d’une minute à l’autre – un rire du Saint-Esprit suscitant en moi une libération rafraîchissante » 5.
De très nombreux exemples pourraient être recueillis concernant cette réaction vraiment étrange à une expérience « spirituelle », et certains apologistes « charismatiques » ont toute une philosophie autour de la « joie spirituelle » et de la « folie de Dieu » pour l’expliquer. Mais cette philosophie n’est pas du tout chrétienne ; un concept tel que le « rire du Saint-Esprit » est inconnu dans toute l’histoire de la pensée et de l’expérience chrétiennes. Ici peut-être plus clairement qu’ailleurs le « renouveau charismatique » se révèle comme étranger à l’orientation religieuse chrétienne ; cette expérience est purement mondaine et païenne, et où elle ne peut pas être expliquée en termes d’hystérie émotionnelle (pour le père Eusèbe, en effet, le rire a fourni « un soulagement » et une « libération » d’un « sentiment de conscience de soi intense et d’embarras » et de « dévastation émotionnelle »), cela ne peut être dû qu’à un certain degré de « possession » par un ou plusieurs dieux païens, que l’Église orthodoxe appelle des démons. Voici, par exemple, une expérience « d’initiation » comparable d’un chaman esquimau païen :
ayant des difficultés à trouver l’initiation, « je tombais parfois en pleurs et me sentais malheureux sans savoir pourquoi. Mais, à un certain moment, sans raison, tout allait soudainement changer, et je ressentais une grande joie inexplicable, une joie si puissante que je ne pouvais pas la retenir, mais je devais éclater en chanson, une chanson puissante, avec de la place pour un seul mot : joie, joie ! Et je devais utiliser toute la force de ma voix. Et puis au milieu d’un tel accès de joie mystérieuse et accablante, je suis devenu un chaman… Je pouvais voir et entendre d’une manière totalement différente. J’avais gagné mon illumination… et ce n’était pas seulement moi qui pouvais voir à travers les ténèbres de la vie, mais la même lumière aveuglante sortait également de moi… et tous les esprits de la terre, du ciel et de la mer sont maintenant venus à moi et sont devenus mes esprits secourables » 6.
Il n’est pas surprenant que des « chrétiens » sans méfiance, s’étant délibérément ouverts à une expérience païenne similaire, l’interprètent encore comme une expérience « chrétienne » ; psychologiquement, ils sont toujours chrétiens, même s’ils sont spirituellement entrés dans le domaine des attitudes et des pratiques clairement non chrétiennes. Quel est le jugement de la tradition ascétique orthodoxe concernant une chose telle que « le rire du Saint-Esprit ! » Les saints Barsanuphe et Jean de Gaza, ascètes du VIe siècle, donnent la réponse orthodoxe sans équivoque à la question d’un moine orthodoxe, victime de ce fléau [Réponse 454] : « Dans la crainte de Dieu, il n’y a pas de rire. Des insensés il est dit : ‹ Ils élèvent leur voix dans le rire › 7 ; Et la parole des insensés est désordonnée, elle est dénuée d’agrément. » Saint Éphrem le Syrien enseigne tout aussi clairement : « Le rire et la familiarité sont le début de la corruption d’une âme. Si vous voyez cela en vous-même, sachez que vous êtes arrivés au plus profond des maux. Ne cessez pas de prier Dieu qu’il vous délivre de cette mort… Le rire nous enlève la bénédiction qui est promise à ceux qui pleurent 8 et détruit ce qui a été construit. Le rire offense le Saint-Esprit, ne donne aucun avantage à l’âme, déshonore le corps. Le rire chasse les vertus, ne se souvient pas de la mort et ne pense pas aux tortures » 9. N’est-il pas évident à quel égarement une personne peut être conduite par ignorance des bases essentielles du christianisme ?
Au moins aussi commun que le rire en réponse au « baptême » charismatique est son parent proche psychologiquement, les larmes. Celles-ci surviennent à des individus et, assez souvent, à des groupes entiers à la fois (dans ce cas, de manière indépendante de l’expérience du « baptême »), se propageant de manière contagieuse sans aucune raison apparente 10. Les écrivains « charismatiques » n’en trouvent pas la raison dans la « conviction de péché » qui produit de résultats semblables dans les réunions protestantes ; ils ne proposent aucune raison du tout, et il semble n’y en avoir aucune, si ce n’est que cette expérience arrive à ceux qui sont exposés à l’atmosphère « charismatique ». Les Pères Orthodoxes, comme le note Mgr Ignace, enseignent que les larmes accompagnent souvent la deuxième forme d’illusion spirituelle. Saint Jean le Climaque, au sujet des nombreuses causes de larmes, certaines bonnes et certaines mauvaises, avertit : « Ne comptez pas sur l’abondance de vos larmes, si vous ne vous sentez pas purifié de vos péchés. » [septième degré § 39] ; et il précise de manière définitive, au sujet d’une sorte de larmes : « les larmes, sans les bonnes pensées, peuvent convenir à des créatures privées de raison, mais absolument pas à des créatures douées d’intelligence et de raison » [septième degré § 20].
Outre les rires et les larmes, se manifestant souvent ensemble, il y a un certain nombre d’autres réactions physiques au « baptême du Saint-Esprit », y compris une sensation de chaleur, de nombreuses sortes de tremblements et de contorsions, et la chute au sol. Tous les exemples donnés ici, il faut le souligner, proviennent des protestants et des catholiques ordinaires, et pas du tout des extrémistes pentecôtistes, dont les expériences sont beaucoup plus spectaculaires et sans retenue.
« Quand on a posé les mains sur moi, j’ai immédiatement eu l’impression que toute ma poitrine essayait de monter dans ma tête. Mes lèvres ont commencé à trembler et mon cerveau s’est mis à se retourner. Puis j’ai commencé à sourire » 11. Un autre était « dépourvu d’émotion suite à l’événement, mais avec une forte chaleur corporelle et une grande aisance » 12. Un autre donne ce témoignage : « Dès que je me suis agenouillé, j’ai commencé à trembler… Tout à coup, je me suis rempli du Saint-Esprit et j’ai réalisé que ‹ Dieu est réel ›. J’ai commencé à rire et à pleurer en même temps. Je me suis retrouvé après prostré devant l’autel et rempli de la paix du Christ » 13. Un autre dit : « Alors que je m’agenouillais doucement pour remercier le Seigneur, D. se prosterna et commença soudain à se soulever par le pouvoir de quelqu’un d’invisible. Par une intuition d’origine divine, certainement… je sû que D. était très visiblement ému par le Saint-Esprit » 14. Un autre : « Mes mains (généralement froides à cause d’une mauvaise circulation) sont devenues humides et chaudes. La chaleur m’a enveloppé » 15. Un autre : « Je savais que Dieu travaillait en moi. Je pouvais sentir un picotement distinct dans mes mains, et subitement je me suis retrouvé baigné dans une forte sueur » 16. Un membre du « Mouvement de Jésus » [Jesus Movement] dit : « Je sentis quelque chose jaillir en moi et tout à coup je parle en langues » 17. Un apologiste « charismatique » souligne que de telles expériences sont typiques du « baptême du Saint-Esprit », qui « a souvent été marqué par une expérience subjective qui a amené le bénéficiaire à un sentiment nouveau et merveilleux de proximité avec le Seigneur. Cela demande quelquefois des formes de culte et d’adoration qui ne peuvent pas être contenues dans les contraintes habituelles imposées par l’étiquette de notre société occidentale ! À ces moments-là, certains sont connus pour trembler violemment, pour lever la main vers le Seigneur, pour élever la voix au-dessus du ton habituel, ou même pour tomber au sol » 18.
On ne sait pas à quoi s’émerveiller le plus : à l’incohérence totale de tels sentiments et expériences hystériques avec quoi que ce soit de spirituel ou à l’incroyable légèreté qui conduit ces personnes égarées à attribuer leurs contorsions au « Saint-Esprit », à l’« inspiration divine », à la « paix du Christ ». Ce sont clairement des gens qui, dans le domaine spirituel et religieux, sont non seulement totalement inexpérimentés et dépourvus de conseils, mais sont absolument analphabètes. L’histoire entière du christianisme orthodoxe ne connaît aucune de ces expériences « extatiques » produites par le Saint-Esprit. Ce n’est que sottise quand certains apologistes « charismatiques » prétendent comparer ces expériences enfantines et hystériques, ouvertes à absolument tout le monde, avec les révélations divines accordées aux plus grands saints, comme Saint-Paul sur le chemin de Damas ou saint Jean l’Évangéliste sur l’île de Patmos. Ces saints sont tombés devant le vrai Dieu (sans contorsions, et certainement sans éclats de rire), alors que ces pseudo-chrétiens ne font que réagir à la présence d’un esprit envahissant et n’adorent qu’eux-mêmes. L’ancien Macaire d’Optina a écrit à une personne dans un état similaire : « En pensant trouver l’amour de Dieu dans des sentiments consolateurs, vous ne cherchez pas Dieu, mais vous-même, c’est-à-dire votre propre consolation, tandis que vous évitez le chemin douloureux, vous considérant perdu sans les consolations spirituelles. » 19. Si ces expériences « charismatiques » sont après tout des expériences religieuses, alors ce sont des expériences religieuses païennes ; et en fait elles semblent correspondre exactement à l’expérience médiumnique d’initiation de la possession spirituelle, qui est causée par « une force jaillissant à l’intérieur tentant de prendre le contrôle » 20. Certainement, tous les « baptêmes du Saint-Esprit » ne sont pas aussi extatiques que certaines de ces expériences (bien que certaines soient encore plus extatiques) ; mais cela aussi est en accord avec la pratique spiritiste : « Quand les esprits trouvent un médium amical ou bien disposé, soumis et d’un esprit passif, ils entrent tranquillement comme dans leur propre maison ; tandis qu’au contraire, lorsque le médium est moins bien disposé à cause de l’opposition ou l’absence de passivité de l’esprit, l’esprit entre avec plus ou moins de force, et cela se reflète souvent dans les contorsions du visage et le tremblement des membres du médium » 21.
Cette expérience de « possession spirituelle », cependant, ne doit pas être confondue avec la possession démoniaque réelle, qui est l’état où un esprit impur s’installe de façon permanente dans quelqu’un et produit des troubles physiques et psychiques qui semblent être absents dans les sources « charismatique ». La « possession » médiumnique est temporaire et partielle, le médium consentant à être utilisé pour une fonction particulière par l’esprit envahisseur. Mais les textes « charismatiques » eux-mêmes montrent clairement que ce qui est impliqué dans ces expériences — lorsqu’elles sont authentiques et pas simplement le produit d’une suggestion — n’est pas simplement le développement d’une capacité médiumnique, mais la possession effective par un esprit. Ces gens semblent avoir raison de se dire « remplis de l’esprit » – mais ce n’est certainement pas le Saint-Esprit dont ils sont remplis ! L’évêque Ignace donne plusieurs exemples de telles manifestations physiques d’illusion spirituelle : le premier, un moine qui tremblait et émettait des sons étranges, et identifiait ces signes comme les « fruits de la prière » ; deuxièmement, un moine que l’évêque rencontra et qui, grâce à sa méthode extatique de prière, sentait une telle chaleur dans son corps qu’il n’avait pas besoin de vêtements chauds en hiver, et cette chaleur pouvait même être ressentie par d’autres. En tant que principe général, écrit Mgr Ignace, le second type d’illusion spirituelle s’accompagne « d’un réchauffement matériel et passionné du sang » ; « le comportement des ascètes du latinisme, gagnés par l’illusion, a toujours été extatique, en raison de cette chaleur matérielle extraordinaire, passionnée » — l’état de « saints » latins comme François d’Assise et Ignace Loyola. Cette chaleur matérielle du sang, signe des trompés spirituellement, doit être distinguée de la chaleur spirituelle ressentie par ceux comme saint Séraphim de Sarov qui ont véritablement acquis le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n’est pas acquis par des expériences extatiques « charismatiques », mais par le long et ardu chemin de l’ascèse, le « chemin douloureux » dont parlait frère Macaire, au sein de l’Église du Christ.

L’église en bois sainte Paraskeva, village de Poieni, département de Timiș
Hieromonk Seraphim Rose, Orthodoxy and The Religion of the Future, pp. 176-185, Saint Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California, 1979
Traduction: hesychia.eu
Vous avez relevé une erreur dans le contenu de cette page, et vous souhaitez la signaler ? Pour cela, surlignez-la, puis appuyez simultanément sur les touches Ctrl + Entrée. Nous procéderons aux corrections si nécessaire et dès que possible.
- Ranaghan, p. 28
- Ranaghan, p. 64
- Sherrill, p. 113
- Sherrill, p. 115
- Logos, avril 1972, p. 4
- Lewis, Ecstatic Religion, p. 37
- Sirach 21 h 23
- Matt. VI.4
- La Philocalie, éd. Russe, Moscou, 1913 : vol. 2, p. 448
- voir Sherrill, p. 109, 117
- Ranaghan, p.67
- Ranaghan, p. 91
- Ranaghan, p. 34
- Ranaghan, p. 29
- Ranaghan, p. 30
- Ranaghan, p. 102
- Ortega, p. 49
- Lillie, p. 17
- Le Starets Macaire d’Optina, Harbin, 1940, p. 100 – en russe
- Koch, Occult Bondage, p. 44
- Blackmore, Spiritisme, p. 97

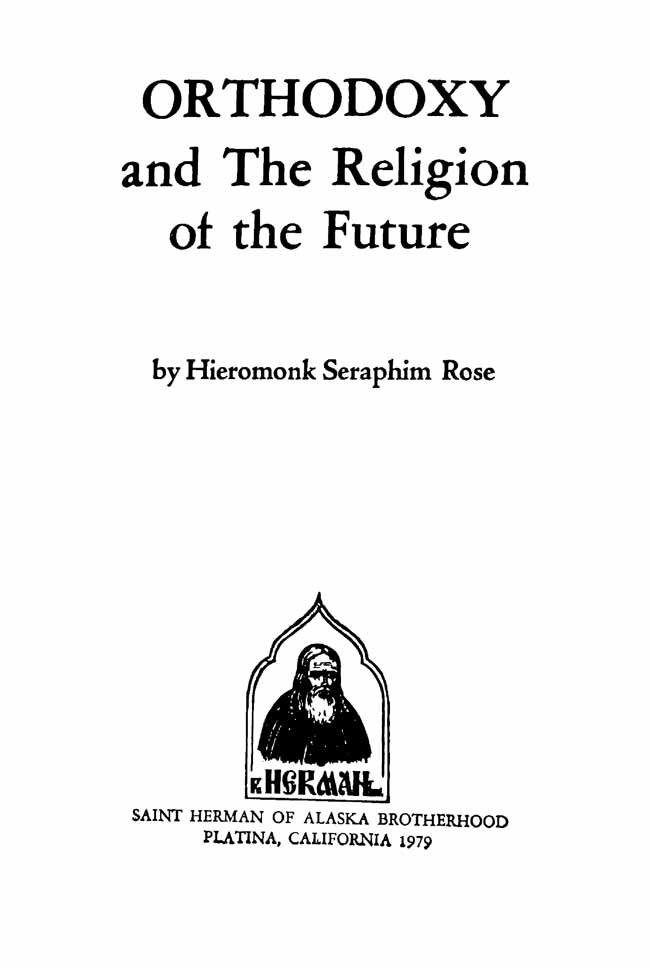

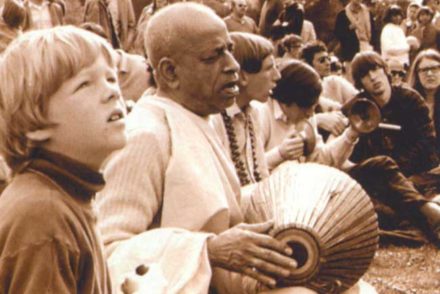


Pas de commentaire