
Le vieux Filipescu nous récitait souvent des passages de Shakespeare qu’il aimait, ou évoquait des souvenirs pour passer le temps. Révolutionnaire de longue date, la première de ses nombreuses arrestations pour agitation politique remontait à 1907. Mais en 1948 la police secrète était venue le chercher. « J’ai souffert pour le socialisme avant que vous soyez nés », dit-il à ceux qui se présentaient. Ils lui répondirent que, dans ce cas, il aurait dû rejoindre le camp du communisme pour partager les fruits de la victoire.
– J’ai dit à ces jeunes gens : « Le socialisme est un corps vivant avec deux bras, la social-démocratie et le communisme révolutionnaire. Coupez-en un et le socialisme devient un infirme ! » Ils ont ri.
Le tribunal avait condamné Filipescu à vingt ans de prison et un geôlier lui avait dit : « Vous allez mourir en prison. » Il lui avait répondu :
— Je n’ai pas été condamné à mort, alors pourquoi voulez-vous me tuer ?
Il nous raconta qu’il avait appris le métier de cordonnier et qu’il avait ensuite beaucoup étudié tout seul et beaucoup lu afin d’être mieux à même d’apprécier ce qui est beau. Il acceptait la doctrine marxiste sur la religion, à savoir que l’Église est du côté de l’oppresseur, que le clergé est payé par les riches pour persuader les pauvres que leur récompense les attend au ciel.
Mais nul ne connaît le fond de son cœur. Exactement comme beaucoup d’entre nous se croient chrétiens et ne le sont pas, de même certains se croient athées sans l’être. Filipescu niait l’existence de Dieu ; mais il niait seulement la conception primitive du mot, pas les réalités d’amour, de droiture et d’éternité.
Je lui suggérai cela.
– Je crois en Jésus-Christ, répondit-il, et L’aime comme le plus grand des êtres vivants, mais je ne peux pas voir Dieu en Lui.
Son état s’aggrava rapidement. En l’espace de quinze jours, après une série d’hémorragies, la fin fut là. Il m’adressa ses dernières paroles :
– J’aime Jésus, murmura-t-il.
Il y avait eu plusieurs décès cette semaine-là et on le jeta tout nu dans la fosse commune creusée par les prisonniers.
Lorsqu’il connut ce détail, Tobescu, un ex-général de gendarmerie, s’écria du fond de son lit :
– C’est le sort que les socialistes occidentaux se préparent lorsqu’ils auront fait alliance avec les communistes.
Mon voisin, l’abbé Iscu, de Tismana, se signa.
– Nous devons du moins être reconnaissants à Dieu que Filipescu soit allé à Lui avant la fin, dit-il d’une voix douce.
Le sergent-major Bucur protesta du fond de la chambre.
– Pas du tout. Il nous a dit qu’il ne pouvait pas voir Dieu dans le Christ.
Je remarquai :
Filipescu a, de toute manière, découvert la vérité à présent dans l’autre monde, car il aimait Jésus qui n’a jamais rejeté personne. Le voleur converti sur le Golgotha, à qui Jésus promit le paradis, considérait lui aussi le Christ comme un homme. Je crois en la divinité de Jésus ; et aussi en son amour pour ceux qui ne voient pas cette divinité.

L’abbé Iscu nous parlait quelquefois de son expérience des camps de détenus appelés à creuser le canal du Danube à la mer Noire ; des milliers d’hommes traités comme des esclaves mouraient minés par la faim et les mauvais traitements. Le canal avait été commencé sous la pression des Russes — qui y voyaient un moyen encore plus rapide que ceux déjà employés de drainer vers leur pays les richesses de la Roumanie — mais c’était aussi un projet de prestige pour notre gouvernement. C’était un immense dessein et il était devenu un tel symbole de l’œuvre communiste que lorsqu’un groupe d’ingénieurs prévint que le fleuve ne pourrait alimenter le canal et son réseau de canaux d’irrigation, on les accusa d’être des « saboteurs économiques » et on les fusilla tous. Des sommes considérables furent dilapidées, deux cent mille prisonniers politiques et de droit commun travaillèrent à le construire entre 1949 et 1953.
L’abbé Iscu était à Poarta-Alba, l’une des colonies pénitentiaires situées le long du tracé. Vivant dans des baraquements délabrés, derrière des fils de fer barbelés, douze mille individus devaient enlever chacun huit mètres cubes de terre par jour. Ils remontaient des plans inclinés en poussant des brouettes de terre sous les coups des gardes ; la température descendait à — 25 °C. en hiver et l’eau apportée dans des tonneaux gelait. La maladie régnait en maître. Beaucoup de prisonniers se rendaient délibérément dans les parties interdites du camp dans l’espoir d’être abattus.
Les détenus de droit commun, les plus brutaux, avaient la charge d’une « brigade » d’une centaine de prisonniers et étaient récompensés, selon les résultats, par un supplément de nourriture ou des cigarettes. Le clergé était groupé dans la « brigade des prêtres ». Si l’on y surprenait un homme en train de se signer, on le rouait de coups. Il n’y avait pas de jour de repos, pas de Noël, pas de Pâques.
Cependant, l’abbé fut témoin à Poarta-Alba d’actes d’une grande noblesse. Un jeune catholique, le Père Cristea, s’attira l’inimitié d’un prêtre orthodoxe, devenu délateur, qui lui demanda un jour :
— Pourquoi fermez-vous les yeux si souvent ? Pour prier ? Je vous mets au défi de dire la vérité : croyez-vous encore à Dieu ?
Répondre « oui » signifiait au moins le fouet.
Le Père Cristea réfléchit :
— Je vois, Andreescu, que vous me tentez, comme les pharisiens tentèrent Jésus, pour m’accuser. Mais Jésus leur dit la vérité et je vous la dirai : Oui, je crois en Dieu.
— Parfait ! Croyez-vous aussi au pape ?
— Je crois aussi au pape.
Andreescu courut à l’officier politique qui vint faire sortir le jeune homme des rangs. Cristea était menu, épuisé, et il tremblait sous ses haillons. L’officier était bien nourri, chaudement vêtu d’une longue capote et la tête couverte d’un bonnet de fourrure.
— On me dit que tu crois en Dieu, dit-il.
Le Père Cristea ouvrit la bouche pour répondre et on comprit alors pourquoi il est écrit dans l’Évangile selon saint Matthieu, avant le sermon sur la montagne, que Jésus « ouvrit la bouche et parla » — chose sûrement étrange, car personne ne parle la bouche fermée —. Donc Cristea avait simplement entrouvert les lèvres pour parler, mais chacun sentit qu’en cet instant crucial il ne pouvait tomber qu’une perle mémorable de sa bouche. Les chrétiens présents furent saisis d’une crainte respectueuse.
Cristea dit :
— Lorsque j’ai été ordonné prêtre, je savais que des milliers de prêtres depuis l’origine de l’Église ont payé leur foi de leur vie. Et chaque fois que je suis monté à l’autel, j’ai fait cette promesse à Dieu : « Aujourd’hui je te sers avec de beaux vêtements, mais même si on devait me mettre en prison, je continuerai à te servir. » De sorte que, mon lieutenant, la prison n’est pas un argument contre la religion. Je crois en Dieu.
Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit du vent. Le lieutenant semblait avoir perdu l’usage de la parole. 11 dit enfin :
— Et croyez-vous au pape ?
La réponse ne tarda pas.
— Depuis saint Pierre il y a toujours eu un pape. Et jusqu’à ce que Jésus revienne, il y en aura un. Le pape actuel n’a pas fait la paix avec les communistes et ses successeurs ne la feront pas. Oui, je crois au pape !
L’abbé Iscu ajouta :
— Il m’a été dur de pardonner à mon frère orthodoxe devenu un mouchard, et je ne reconnais pas la suprématie du siège apostolique, mais à cet instant je fus tenté de crier : Viva il Papa !
— Qu’est-il arrivé au Père Cristea ? demanda quelqu’un.
— On l’enferma pendant une semaine dans un cachot où l’on ne peut se tenir que debout, où il est impossible de dormir et on le battit. Comme il continuait à refuser de renier sa foi, on l’emmena. Nous ne l’avons plus jamais revu.
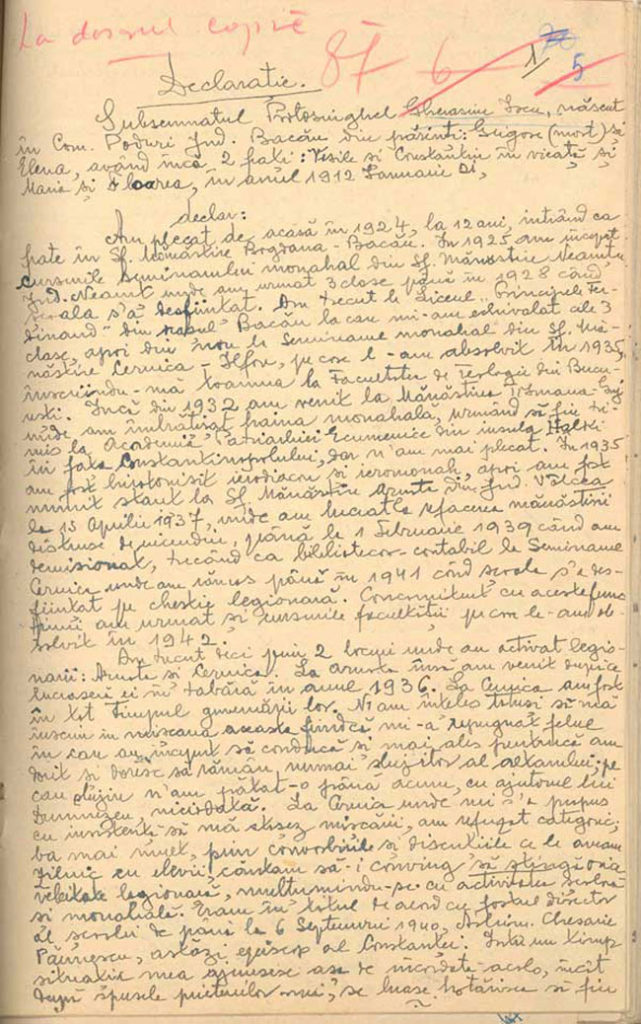
L’abbé Iscu avait chaque jour des quintes de toux un peu plus longues. Son organisme, miné par des années de privations et de travaux épuisants sur le canal, subissait de terribles assauts. Couchés sur nos grabats, impuissants, nous le regardions mourir. Parfois, il ne reconnaissait même pas les amis venus l’assister, mais lorsqu’il était conscient, il passait des heures à réciter tout bas des prières et il avait toujours un mot de réconfort pour les autres.
D’autres survivants du canal étaient arrivés à Tirgul-Ocna, et le récit des horreurs qu’ils y avaient connues rappelait l’esclavage d’Israël en Égypte, auquel s’ajoutait ici pour l’opprimé l’amertume de devoir louer l’oppresseur. Un compositeur célèbre qui se trouvait au nombre des prisonniers avait dû écrire un hymne à la gloire de Staline, que les brigades chantaient en se rendant au travail.
Un jour où un homme s’était écroulé et après qu’un médecin eut constaté son décès, le colonel Albon, le commandant haï de Poarta-Alba, cria en donnant un coup de pied au cadavre :
— Bêtises ! Mettez-le au travail !
Mon lit était placé entre celui de l’abbé Iscu et celui du jeune Vasilescu, qui était une victime du canal d’un genre différent. Prisonnier de droit commun, Vasilescu était l’un des responsables de la « brigade des prêtres » qu’il ne se faisait pas faute de malmener jusqu’à ce qu’ils s’effondrent. Mais on ne savait pourquoi le colonel Albon le détestait et il fut traité si brutalement à son tour qu’il faillit en mourir lui aussi. Sa tuberculose était très avancée lorsqu’il arriva dans la chambre 4.
Vasilescu n’était pas foncièrement mauvais. Il avait un visage carré, mal dégrossi, surmonté de cheveux noirs frisés plantés bas sur le front, ce qui lui donnait l’air effaré d’un jeune taureau. Obstiné, ignorant, trop épris de ce qu’il considérait comme les bonnes choses de la vie pour s’astreindre à un travail régulier, il avait eu une existence difficile. Victime des coups du sort comme le tueur à gages de Macbeth, il était prêt à tout pour se venger du monde.
Il nous dit :
— Une fois que l’on est entré dans ces camps on ferait n’importe quoi pour en sortir, n’importe quoi ! Et Albon m’avait promis que si je lui obéissais on me libérerait.
Le jeune homme avait envie de vêtements et d’une fille pour aller danser. Et le parti lui donna à choisir de s’allier aux victimes ou aux bourreaux.
— Un certain nombre d’entre nous furent conduits dans un camp spécial où les communistes entraînent la police secrète. Nous devions, par exemple, tuer à coups de revolver des chats et des chiens et achever les moribonds à coups de poignard. J’ai dit : « Je ne peux pas faire ça ! » L’instructeur m’a répondu : « Alors, on te le fera à toi ! ».
Vasilescu regrettait maintenant son passé et me parlait sans fin des choses terribles qu’il avait faites sur le canal. Il n’avait pas épargné l’abbé Iscu. Vasilescu était évidemment en train de mourir et j’essayai de lui apporter un peu de consolation, mais il ne trouvait pas le repos. Il s’éveilla une nuit, respirant avec difficulté.
— Pasteur, je m’en vais, haleta-t-il. Priez pour moi.
Il s’assoupit, se réveilla de nouveau et cria : « Je crois en Dieu », et il commença à pleurer.
À l’aube, l’abbé Iscu appela deux prisonniers près de son lit et leur ordonna de l’aider à se lever.
— Vous êtes trop malade pour bouger, dirent-ils, tandis que tout le monde avait la gorge serrée.
— Qu’y a-t-il ? demandèrent certains. Laissez-nous-le faire à votre place.
— Vous ne pouvez pas ! Levez-moi !
Ils le mirent debout.
— Conduisez-moi près de Vasilescu.
L’abbé s’assit sur le lit à côté du jeune homme qui l’avait torturé et posa doucement une main sur son bras.
— Sois tranquille, murmura-t-il. Tu es jeune. Tu savais à peine ce que tu faisais. (Il essuya avec une loque la sueur qui perlait sur le front du jeune homme.) Je te pardonne du fond du cœur, comme les autres chrétiens te pardonneraient aussi. Et si nous te pardonnons, sûrement que le Christ, qui est meilleur que nous, te pardonnera. Il y a une place dans le ciel pour toi aussi.
Il reçut la confession de Vasilescu et lui donna la sainte communion avant d’être reporté dans son lit.
L’abbé et Vasilescu moururent la nuit suivante. Je crois qu’ils entrèrent au ciel la main dans la main.

Richard Wurmbrand, Mes prisons avec Dieu, Casterman, 1969, p. 76-77/94-96/98-99




Pas de commentaire