(Краткая повесть об антихристе)
par Vladimir Soloviev (Соловьёв Владимир Сергеевич) / 1853 – 1900
Dans une villa située au bord de la Méditerranée, cinq Russes se sont rencontrés par hasard : un vieux général, un homme politique, un jeune prince, une dame, et un inconnu (Monsieur Z). Soloviev nous rapporte trois de leurs conversations. C’est à la dernière qu’est emprunté le fragment ci-dessous.

L’HOMME POLITIQUE. — Puisqu’il est bien clair maintenant que ni les athées, ni les « vrais chrétiens » de l’espèce du prince ne représentent l’Antichrist, il serait temps que vous nous fissiez son portrait.
MONSIEUR Z. — C’est cela que vous voulez ! Mais êtes-vous satisfait par l’une quelconque des nombreuses représentations du Christ, sans en exclure celles qui sont dues à des peintres de génie ? Pour ma part, aucune ne me satisfait. Je suppose que cela vient de ce que le Christ est l’incarnation, unique en son genre et par suite ne ressemblant à aucune autre, de son essence, le bien. Pour le représenter, le génie artistique est insuffisant. Il faut dire la même chose de l’Antichrist, qui est une in-carnation, unique dans sa perfection, du mal. Il est impossible de faire son portrait. Dans la littérature religieuse nous trouvons seulement son passeport et les grands traits de son signalement.
LA DAME. — Dieu nous garde d’avoir son portrait ! Expliquez-nous plutôt pourquoi vous le tenez pour nécessaire, en quoi consistera son œuvre, et dites-nous s’il viendra bientôt.
MONSIEUR Z. — Je puis vous satisfaire mieux que vous ne pensez. Il y a quelques années, un de mes camarades d’études, qui s’était fait moine, me laissa en mourant un manuscrit auquel il te-nait beaucoup, mais qu’il n’avait ni voulu, ni pu imprimer. Il a pour titre : « Courte nouvelle sur l’Antichrist ». Dans le cadre d’un tableau historique préconçu, cette composition donne, à mon sens, tout ce qu’on peut dire de plus vraisemblable sur ce sujet, conformément aux Saintes Écritures, à la tradition de l’Église et au bon sens.
L’HOMME POLITIQUE. — L’auteur ne serait-il pas notre ami Varsonophii ?
MONSIEUR Z. — Non, on lui donnait un nom plus recherché : Pansophii.
L’HOMME POLITIQUE. — Pan Sophii ? Un polonais ?
MONSIEUR Z. — Pas le moins du monde, c’était le fils d’un prêtre russe. Si vous me donnez une minute pour monter jusqu’à ma chambre, je vous apporterai ce manuscrit et vous le lirai ; il n’est pas long.
LA DAME. — Allez ! Allez ! Et revenez vite.
Pendant que Monsieur Z. va prendre le manuscrit, la compagnie se lève et se promène dans le jardin.
L’HOMME POLITIQUE. — Je ne sais ce que c’est, est-ce ma vue qui est brouillée par l’âge, ou est-ce la nature qui est changée ? Mais je remarque qu’en aucune saison et en aucun lieu je ne vois plus maintenant les claires et transparentes journées d’autrefois. Voyez donc aujourd’hui : pas un nuage ; nous sommes assez loin de la mer et pourtant tout semble très légèrement ombré ; ce n’est pas la clarté parfaite. Le remarquez-vous, général ?
LE GENERAL. — Voilà déjà bien des années que je le remarque.
LA DAME. — Je le remarque aussi depuis un an, mais dans mon âme comme dans l’atmosphère ; je ne vois pas non plus ici cette « clarté parfaite » dont vous parlez. Partout semble régner comme une inquiétude, comme le pressentiment d’une catastrophe. Je suis convaincue, prince, que vous aussi sentez cela.
LE PRINCE. — Non, je ne remarque rien de particulier : l’atmosphère me semble être ce qu’elle a toujours été.
LE GENERAL. — Vous êtes trop jeune pour voir la différence : vous n’avez pas de terme de com-paraison. Quand je me reporte à l’époque où j’avais cinquante ans, comme la différence est sensible !
LE PRINCE. — Je crois que votre première supposition est la vraie ; votre vue s’est affaiblie.
L’HOMME POLITIQUE. — Nous nous faisons vieux, c’est certain ; mais la terre non plus ne rajeunit pas ; et l’on sent comme une double lassitude.
LE GENERAL. — Le plus probable, c’est que le diable avec sa queue met un brouillard dans la clarté divine.
LA DAME, montrant Monsieur Z. qui descend de la terrasse. — Nous allons être bientôt renseignés.
Tous reprennent leurs places antérieures et Monsieur Z. commence la lecture du manuscrit.
MONSIEUR Z. — « Courte nouvelle sur l’Antichrist. »
Panmongolisme ! Le mot est sauvage
Mais ses syllabes me caressent
Comme si elles contenaient une grande prévision
Des destins que Dieu nous réserve.
LA DAME. — D’où est tirée cette épigraphe ?
MONSIEUR Z. — Je pense que l’auteur de la nouvelle l’a lui-même composée.
LA DAME. — Continuez donc.
MONSIEUR Z. lit :
Le vingtième siècle de l’ère chrétienne fut l’époque des dernières grandes guerres, discordes intestines et révolutions. La guerre la plus importante avait pour cause lointaine le mouvement d’idées né au Japon à la fin du XIXe siècle et appelé panmongolisme. Les Japonais imitateurs s’étaient assimilés avec une rapidité et un succès étonnants le côté matériel de la civilisation européenne et même quelques idées européennes d’espèce inférieure. Ayant appris dans les journaux et les manuels d’histoire qu’il existait en Occident un panhellénisme, un pangermanisme, un panslavisme, un panislamisme, ils avaient proclamé la grande idée du panmongolisme, c’est-à-dire, de l’union, sous leur autorité, de tous les peuples de l’Asie orientale, en vue d’une lutte décisive contre les étrangers, c’est-à-dire, les Européens. Ils avaient profité de ce que l’Europe, au commencement du XXe siècle, était occupée à en finir avec le monde musulman, pour entreprendre l’exécution de leur grand dessein, en s’emparant d’abord de la Corée, ensuite de Pékin, où, avec l’aide du parti progressiste chinois, ils avaient jeté bas la vieille dynastie mandchoue et mis à sa place une dynastie japonaise. Les conservateurs chinois s’étaient vite accommodés de la chose. Ils avaient compris que, de deux maux, il vaut mieux choisir le moindre. La vieille Chine ne pouvait plus d’aucune façon conserver son indépendance et devait nécessairement se soumettre soit aux Européens, soit aux Japonais. Il était clair que la domination japonaise en détruisant les formes extérieures, et d’ailleurs bonnes à rien, de l’administration chinoise, ne touchait pas aux principes intérieurs de la vie nationale, tandis que la domination des puissances européennes, qui soutenaient pour des raisons poli-tiques les missionnaires chrétiens, aurait menacé les fondements spirituels de la Chine. La haine, qui divisait auparavant les Chinois et les Japonais, était née quand ni ceux-ci, ni ceux-là ne connaissaient les Européens, à la face desquels l’inimitié de deux nations parentes devenait une vraie dis-corde intestine et perdait tout sens. Les Européens étaient complètement des étrangers, uniquement des ennemis et leur domination ne pouvait en rien flatter l’amour-propre national des Chinois ; tandis qu’entre les mains des Japonais, la Chine se laissait prendre à l’appât du panmongolisme, qui justifiait en outre la triste nécessité de s’européaniser extérieurement : « Sachez bien, frères entêtés, avaient dit les Japonais, que nous prenons leurs armes aux chiens d’Europe, non par goût pour elles, mais afin de les battre avec. Si vous vous unissez à nous et acceptez notre direction, non seulement nous chasserons bientôt de notre Asie les diables blancs, mais encore nous conquerrons leurs territoires et établirons sur l’univers l’Empire du Milieu. Vous avez raison de garder votre fierté nationale et de mépriser les Européens, mais vous avez tort de nourrir ces sentiments de rêveries et non d’activité raisonnable. Nous vous avons devancé sur ce point et nous devons vous montrer la route des intérêts communs. Sinon, voyez vous-mêmes, ce que vous a donné votre politique de con-fiance en soi et de méfiance pour nous, vos amis et vos défenseurs naturels : c’est à peine si la Russie et l’Angleterre, l’Allemagne et la France ne se sont pas entièrement partagé la Chine et toutes vos fantaisies de tigres n’ont abouti qu’à montrer une débile queue de serpent. » Les Chinois avaient trouvé ces remarques fondées et la dynastie japonaise s’était solidement établie. Son premier souci avait été, cela va de soi, de constituer une armée et une flotte puissantes. La plus grande partie des forces militaires du Japon avait été transportés en Chine où elle avait servi de cadre à une nouvelle et énorme armée. Les officiers japonais, connaissant la langue chinoise, avaient été des instructeurs bien plus efficaces que les officiers européens et l’innombrable population de la Chine avec la Mandchourie, la Mongolie et le Tibet, avait fourni un contingent suffisant. Le premier empereur de la dynastie japonaise put faire un heureux essai de ses armes en chassant les Français du Tonkin et du Siam, les Anglais de la Birmanie et en incorporant à l’Empire du Milieu toute l’Indo-Chine. Son successeur, dont la mère était chinoise, et en qui s’unissaient la ruse et l’entêtement chinois avec l’énergie, la mobilité et la force d’assimilation japonaises, mobilisa dans le Turkestan chinois une armée de quatre millions d’hommes. Pendant que Tsun-Li-Iamyn déclare confidentiellement à l’ambassadeur russe que cette armée est destinée à la conquête de l’Inde, l’Empereur pénètre dans l’Asie centrale russe, y soulève toute la population, traverse l’Oural et inonde de son armée toute la Russie centrale et orientale, tandis que les armées russes mobilisées se hâtent de se concentrer, venant de Pologne et de Livonie, de Kiew et de Volhynie, de Pétersbourg et de la Finlande. Dans l’absence d’un plan de guerre et devant l’énorme supériorité numérique de l’ennemi, les qualités militaires de l’armée russe ne lui servent qu’à périr avec honneur. La rapidité de l’envahisseur ne laisse pas le temps d’une bonne concentration et les corps d’armée sont détruits les uns après les autres dans des combats cruels et désespérés. Certes, la victoire coûte cher aux Mongols, mais ils ré-parent facilement leurs pertes en s’emparant de tous les chemins de fer d’Asie, tandis que deux cent mille Russes concentrés depuis longtemps aux frontières de la Mandchourie font un essai malheureux de pénétration dans la Chine bien défendue. L’envahisseur laisse une partie de ses forces en Russie, afin d’empêcher la formation de nouveaux corps et pénètre avec trois armées en Allemagne. Les Allemands ont eu le temps de se préparer et une des armées mongoles est écrasée. Mais à ce moment le parti de la revanche l’emporte en France et bientôt un million de baïonnettes françaises tombent sur le dos des Allemands. Pris entre l’enclume et le marteau, les Allemands sont forcés d’accepter les conditions posées par le chef mongol et désarment. Les Français sont dans la joie ; ils fraternisent avec les Jaunes, se répandent en Allemagne et perdent bientôt la moindre notion de la discipline militaire. Le chef mongol ordonne alors à ses armées d’égorger des alliés désormais inutiles, ce qui est fait avec une ponctualité toute chinoise. Les ouvriers « sans patrie » se soulèvent à Pa-ris et la capitale de la culture occidentale ouvre joyeusement ses portes au maître de l’Orient. Celui-ci, une fois sa curiosité satisfaite, se dirige vers Boulogne où, sous la protection d’une flotte venue du Pacifique, se préparent des transports destinés à faire aborder son armée en Grande-Bretagne. Mais il a besoin d’argent et les Anglais évitent l’invasion en lui versant 25 milliards de livres sterlings. Au bout d’un an, tous les États de l’Europe reconnaissent sa suzeraineté ; il laisse alors en Europe une suffisante armée d’occupation, retourne en Orient et projette de débarquer en Amérique et en Australie. Ce nouveau joug mongol pèse un demi-siècle sur l’Europe. Au point de vue moral, cette époque est marquée par le mélange sur tous les points et la pénétration réciproque et profonde des idées européennes et des idées orientales, par la répétition en grand de l’antique syncrétisme d’Alexandrie ; au point de vue matériel, trois grands phénomènes sont particulièrement caractéristiques de cette époque : les ouvriers japonais et chinois inondent l’Europe et rendent plus aiguë la question sociale et économique ; les classes dirigeantes continuent d’essayer de résoudre cette question par une série de palliatifs ; on assiste enfin à l’activité d’organisations internationales secrètes qui préparent un grand complot européen pour chasser les Mongols et rétablir l’indépendance de l’Europe. Ce colossal complot auquel prennent part les gouvernements nationaux, autant que le permet le contrôle des vice-rois mongols, est préparé de main de maître et réussit brillamment. Au moment convenu, les soldats mongols sont égorgés, les ouvriers asiatiques sont assommés et ex-pulsés. En tous lieux se font jour les cadres secrets des armées européennes et une mobilisation générale a lieu sur des plans préparés longtemps d’avance et tout à fait opportuns. Le nouvel Empereur mongol, petit-fils du grand conquérant, accourt de Chine en Russie, mais ses troupes innombrables sont écrasées par l’armée européenne. Leurs restes dispersés retournent au cœur de l’Asie et l’Europe reste libre. Tandis que la soumission de l’Europe aux barbares d’Asie pendant un demi-siècle, avait eu pour cause la désunion des États Européens, la grande et glorieuse libération de l’Europe était due au contraire à l’organisation des forces unies de toute la population européenne. La conséquence naturelle de ce fait patent est que le vieux régime traditionnel des nations distinctes perd partout sa signification et que presque partout disparaissent les derniers restes des vieilles institutions monarchiques. L’Europe au XXIe siècle est une union d’États plus ou moins démocratiques, les États-Unis d’Europe. Les progrès de la civilisation matérielle, un peu retardés par l’invasion mongole et la guerre d’émancipation, reprennent une marche accélérée. Mais les objets de la conscience interne, les problèmes de la vie et de la mort, de la destination du monde et de l’homme, compliqués et obscurcis par une grande quantité de nouvelles études et de recherches physiologiques et psychologiques, restent sans réponse comme avant. Un seul résultat négatif important est atteint : l’abandon décidé du matérialisme théorique. Aucun esprit sensé ne se satisfait plus de la conception qui fait du monde un système d’atomes en mouvement et, de la vie, le résultat de l’accumulation mécanique des transformations de la matière. L’humanité a dépassé pour toujours ce stade de jeunesse philosophique. Mais il est clair d’autre part qu’elle n’est plus capable de foi naïve et non raisonnée. Des notions comme celle d’un Dieu faisant le monde de rien, ne s’enseignent même plus dans les écoles primaires. Les représentations des objets de cet ordre ont atteint un ni-veau général élevé, au-dessous duquel aucun dogmatisme ne peut descendre. Et si la grande majorité des gens qui pensent reste tout à fait sans foi, les rares croyants sont tous nécessairement des penseurs qui obéissent aux prescriptions de l’apôtre : soyez jeunes par le cœur et non par l’intelligence.

En ce temps-là, parmi ces rares croyants spiritualistes, vivait un homme remarquable. Beaucoup l’appelaient Sur-homme. Il était également loin de la jeunesse de l’intelligence et de la jeunesse du cœur. Il était encore jeune, mais, grâce à son génie, il jouissait à trente-trois ans du renom de grand penseur, de grand écrivain et de grand homme d’action. Sentant en lui-même la grande puissance de l’esprit, il avait toujours été un spiritualiste convaincu et sa claire intelligence lui avait toujours montré la vérité des notions auxquelles il faut croire : le bien, Dieu et le Messie. Il croyait en ces vérités, mais il n’aimait que soi. Il croyait en Dieu, mais au fond de son âme il se préférait in-volontairement à Dieu. Il croyait au Bien, mais l’Œil Éternel qui voit tout savait qu’il s’inclinerait devant la force du mal pourvu qu’elle l’achète, non qu’il fût égaré par ses sentiments, par de basses passions ou par l’attrait du pouvoir, mais parce qu’il avait un amour-propre démesuré. Cet amour-propre, d’ailleurs, n’était ni un instinct irraisonné, ni une prétention folle. En plus de son exceptionnel génie, de sa beauté et de sa noblesse, les hautes preuves qu’il avait données de sa tempérance, de son désintéressement et de sa générosité, semblaient justifier assez l’immense amour-propre de ce grand ascète et de ce grand philanthrope spiritualiste. Si on lui faisait un grief d’être si abondamment pourvu de dons divins, il voyait en ces dons la marque de l’exceptionnelle bienveillance de Dieu à son endroit, il se mettait au premier rang après Dieu et se considérait comme l’unique Fils de Dieu. En un mot, il croyait être ce que le Christ fut réellement. Mais cette conscience de sa haute dignité ne faisait pas naître en lui le sentiment d’une obligation morale à l’égard de Dieu et du monde, mais le sentiment de son droit à l’emporter sur les autres et, avant tout, sur le Christ. Dans le principe, il n’avait pas de haine pour Jésus. Il reconnaissait le Messianisme et la dignité du Christ, mais il voyait sincèrement en Lui son grand prédécesseur. L’action morale du Christ et Son absolue originalité échappaient à son intelligence obscurcie par l’amour-propre. « Le Christ, pensait-il, est venu avant moi ; je viens le second ; mais ce qui suit dans le temps, précède dans l’être. Je viens le dernier, à la fin de l’histoire, précisément parce que je suis le sauveur définitif et parfait. Le Christ fut mon annonciateur. Il eut pour mission de préparer mon apparition. » Fort de cette pensée, le grand homme du XXIe siècle va s’appliquer tout ce que dit l’Évangile de la seconde venue ; il entendra cette venue non pas comme le retour du premier Christ, mais comme le remplacement du Christ préparatoire, par le Christ définitif, par lui-même.
Arrivé à ce stade, il présente peu de caractéristiques originales. Son attitude vis-à-vis du Christ est celle de Mahomet, par exemple, homme juste qu’on ne peut accuser d’aucune mauvaise pensée.
Le grand homme du XXIe siècle va justifier d’une autre manière encore le fait qu’il se met avant le Christ : « Le Christ, dit-il, en enseignant et en réalisant dans sa vie le bien moral, a été le redresseur de l’humanité, moi, je dois être le bienfaiteur de cette humanité en partie redressée, en partie non redressée. Je donnerai aux hommes tout ce dont ils ont besoin. En sa qualité de moraliste, le Christ a divisé les hommes par les notions du bien et du mal, moi je les unirai par les bienfaits qui sont également nécessaires aux bons et aux méchants. Je serai le vrai représentant du Dieu qui fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le Christ a apporté un glaive ; moi, j’apporterai la paix. Il a menacé la terre du jugement dernier ; mais c’est moi qui serai le juge et mon jugement ne sera pas le jugement de la seule justice, mais celui de la miséricorde. La justice contenue dans mes sentences sera une justice distributive et non rémunératrice. Je ferai la part de chacun, et chacun aura ce qu’il lui faut ».

Dans ce magnifique état esprit, le voilà qui attend que Dieu le convie d’une façon claire à l’œuvre du salut nouveau de l’humanité, et témoigne par une marque certaine et frappante qu’il est son fils aîné et préféré. Il attend et remplit son attente de la conscience de ses vertus et de ses dons surhumains ; car il est, comme on dit, un homme d’une moralité sans tache et d’un génie extraordinaire.
Notre Juste attend donc fièrement les ordres d’en haut pour commencer son œuvre de salut ; mais il se lasse d’attendre. Il a dépassé trente ans et trois années se passent encore. Une inquiétude lui vient, qui le pénètre jusqu’à la moelle et le fait frissonner de fièvre : « Si par hasard, pense-t-il, ce n’était pas moi… mais l’autre, le Galiléen… S’il n’était pas mon annonciateur, mais le vrai Christ, le premier et le dernier !… Mais, dans ce cas, il doit être vivant… Où donc est-il ?… S’il venait tout à coup devant moi, ici…. que Lui dirais-je ? Je devrais m’incliner devant Lui, comme le dernier et le plus borné des chrétiens, comme le paysan russe qui marmotte sans comprendre : Seigneur, Jésus-Christ, aie pitié de mes péchés. Or, je suis un brillant génie, un sur-homme. Non, jamais je ne ferai cela. » Alors à la place du respect froid et raisonnable qu’il avait pour Dieu et pour le Christ, il voit naître et grandir en son cœur d’abord de l’effroi, puis une envie, qui brûle et consume tout son être, enfin une haine ardente qui s’empare de son esprit. « C’est moi, c’est moi et non pas Lui ! Il n’est pas parmi les vivants ; il n’y est pas et n’y sera pas. Il n’est pas ressuscité ! Il n’est pas ressuscité ! Il n’est pas ressuscité ! Il a pourri, il a pourri, dans son tombeau, il a pourri comme la dernière… ». Sa bouche écume, il bondit hors de sa maison et de son jardin et, dans la nuit noire, prend en courant un sentier escarpé. Sa rage tombe et fait place à un désespoir sec et lourd comme les rocs, sombre comme la nuit. Il s’arrête devant un précipice et entend là-bas dans le lointain le bruit confus d’un torrent roulant sur les rochers. Une angoisse insupportable pèse sur son cœur. Soudain la pensée lui vient de L’appeler, de Lui demander ce qu’il doit faire. Dans l’ombre paraît une figure humble et triste. « Il a pitié de moi, pense-t-il. Non jamais ! Il n’est pas ressuscité ! Il n’est pas ressuscité ! » Et il s’élance dans le précipice. Mais quelque chose d’élastique comme une colonne d’eau le maintient en l’air, il est ébranlé comme par un choc électrique et une force le rejette en arrière. Il perd un moment conscience et s’éveille à genoux à quelques pas de distance du précipice. Devant lui se dessine une figure éclairée d’une vaporeuse lumière phosphorescente et dont les regards insupportablement pénétrant lui vont jusqu’à l’âme.
Il voit ces deux yeux perçants, et il entend une voix étrange, sourde, contenue et en même temps très nette, métallique et sans âme comme celle d’un phonographe. Et cette voix, dont il ne peut dire si elle vient du fond de lui-même ou du dehors, lui dit : « Je te donne ma bénédiction, fils bien-aimé. Pourquoi ne m’as-tu pas imploré, moi ? Pourquoi as-tu honoré l’autre, le méchant, et son père ? Je suis ton dieu et ton père, tandis que l’autre, le pauvre crucifié, est étranger à toi et à moi. Je n’ai pas d’autre fils que toi. Tu es unique, tu es de mon sang, tu es mon égal. Je t’aime et ne te demande rien. Tel que tu es, tu es grand, puissant. Fais ton œuvre en ton nom, et non au mien. Je ne t’envie pas. Je t’aime. Il ne me faut rien de toi. L’autre, celui que tu croyais être Dieu, a exigé de son fils l’obéissance et une obéissance sans limite, allant jusqu’à la mort, et il ne l’a pas aidé sur la croix. Je ne te demande rien et je t’aiderai. À cause de ce que tu es, à cause de ton mérite, et de ton excellence, à cause aussi de l’amour désintéressé et pur que j’ai pour toi, je t’aiderai. Reçois mon es-prit. Il t’a créé d’abord en beauté, qu’il te crée maintenant en force. » Sur ces paroles de l’inconnu, les lèvres du sur-homme se sont entr’ouvertes involontairement, les deux yeux perçants se sont rapprochés de son visage, et il a senti comme si un flot glacé entrait en lui et emplissait tout son être. Il s’est en même temps senti une vigueur, une vaillance, une légèreté, un enthousiasme inaccoutumés. À l’instant même les deux yeux ont disparu soudain et une force a soulevé le sur-homme au-dessus de terre et l’a replacé dans son jardin, devant la porte de sa maison.
Le lendemain les visiteurs du grand homme et ses domestiques même étaient surpris de son air inspiré. Mais ils auraient été bien plus étonnés s’ils avaient pu voir avec quelle rapidité et quelle légèreté surhumaine, il écrivait dans son cabinet son ouvrage fameux intitulé : Vers la paix et la prospérité universelles.
Les livres antérieurs et l’activité sociale du sur-homme avaient rencontré des critiques sévères ; mais ces critiques étaient pour la plupart des hommes tout particulièrement religieux et par suite dépourvus de toute autorité, de sorte qu’ils n’avaient pas été entendus quand ils avaient montré dans tous les écrits et toutes les paroles du sur-homme les signes d’un amour-propre exclusif et excessif, l’absence de vraie simplicité, de vraie droiture et de vraie cordialité.
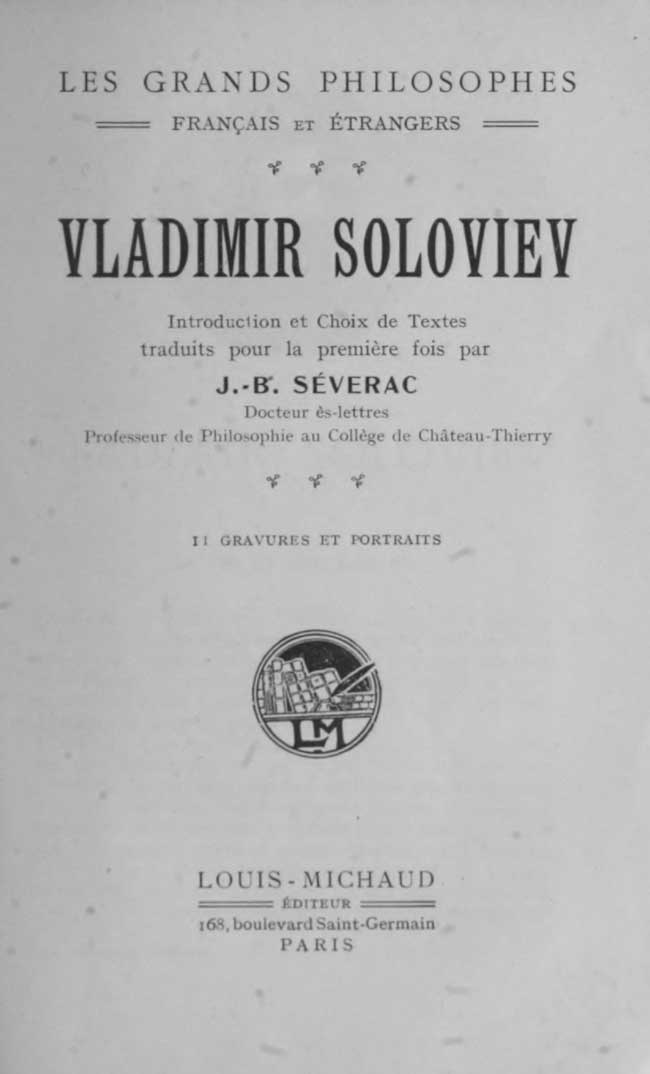
Traduction de J.-B. Séverac, Vladimir Soloviev ; introduction et choix de textes, Paris, Michaud, 1910.
Texte établi par la Bibliothèque russe et slave ; déposé sur le site de la Bibliothèque le 7 mars 2012.
Illustrations issues du film Malmkrog par Cristi Puiu




Pas de commentaire