Rédigées par Dométian, moine-prêtre de Khilandar, au Mont-Athos et disciple de Saint Sabba premier archevêque de Serbie
PRÉFACE DU TRADUCTEUR
Le souvenir des saints personnages dont on lira ici les biographies est encore très populaire au-delà du Danube, bien qu’ils appartiennent à l’époque des croisades et de la dissolution de l’empire d’Orient. Un publiciste de Belgrade remarque que « la Serbie naquit dans le berceau d’Etienne Némania (saint Syméon). » En effet, ce fut lui qui, en 1159, la proclama royaume indépendant, et, après lui avoir annexé la Bosnie, l’Herzégovine et le Monténégro, en forma un État puissant et autonome. Parvenu au faite des grandeurs humaines, Némania eut le courage d’y renoncer volontairement : le 25 mars 1195, il transmit les rênes du gouvernement à l’aîné de ses fils, Étienne II, et alla s’enfermer dans un couvent, où il vécut sous l’humble nom de Syméon le Moine, et mourut le 15 février 1200.

Le fils cadet de Némania, Rastko, mieux connu sous le nom de saint Sabba, couronna l’œuvre si glorieusement inaugurée des libertés politiques et religieuses de Serbie, en l’affranchissant de la suprématie du patriarcat de Byzance. Saint Sabba naquit en 1169. Il quitta la maison paternelle l’an 1186, pour le mont Athos, où il reçut la tonsure, et d’où il ne revint en Serbie que vingt-deux années plus tard, avec les dépouilles mortelles de son père. Depuis 1208 jusqu’à 1215, saint Sabba resta en Serbie comme prieur (higoumène) du monastère de Stoudénitza, s’occupant principalement de l’organisation définitive du clergé national, se trouvant à Constantinople en 1221, il y fut sacré archevêque de Serbie. Dans le courant de l’année 1231, il quitta l’Europe pour aller visiter les lieux saints, et les églises asiatiques et africaines, de Jérusalem, du mont Sinaï, de l’Égypte, de Babylone et de l’Arménie. Il mourut le 14 décembre 1237 dans la ville de Ternov, alors chef-lieu de la Bulgarie. L’église de Rome le reçut au nombre des saints, et, environ trois siècles plus tard, en 1595, les Turcs firent brûler ses reliques à Belgrade.
Toutes ces dates manquent au texte de notre traduction. Le doyen des slavistes modernes, M. Safarizk, dans son précieux recueil des Monuments de l’ancienne littérature des Slaves méridionaux, publia deux biographies de saint Syméon, écrites par ses deux fils, saint Sabba et le roi Étienne II. Une copie de cette dernière fait partie des manuscrits slaves de la Bibliothèque impériale de Paris, manuscrits dont un excellent compte rendu vient d’être publié par le savant Père Martinof, avec une traduction de l’œuvre d’Étienne .
Quant à la vie de saint Sabba, écrite par son disciple Dométian (célèbre en 1264), elle ne fut éditée, que je sache, qu’une seule fois, par l’évêque orthodoxe Givkovich, à Vienne, 1794. Malheureusement l’éditeur cherche à satisfaire ses rancunes religieuses plutôt qu’à nous donner la reproduction fidèle du texte, qu’il avoue lui-même avoir abrégé et épuré. Les philologues slaves qui jouissent de l’avantage de pouvoir consulter le manuscrit de Dométian n’ont pas rempli ces lacunes. L’intolérance orthodoxe de l’évêque lui aura conseillé de supprimer les passages qui constatent l’action que l’Église latine exerçait alors dans les pays professant aujourd’hui le rite gréco-slave. Ainsi, par exemple, M. Safarik et l’auteur d’une esquisse biographique sur saint Sabba (publiée dans le VIIIe cahier de la Revue serbe Glasnik, 1856 à Belgrad), citent un passage de Dométian, d’après lequel Étienne II, le jour de son sacre, en 1222, porta une couronne envoyée, sur sa demande, par le pape Honorius III. Le texte de l’édition de Givkovich n’en dit rien, mais en revanche il conserve les passages relatifs à la conversion du roi catholique de Hongrie au schisme grec. Nous n’avons pas à nous prononcer pour ni contre aucun des partis hostiles, mais il nous semble que ces contradictions, loin d’invalider l’exactitude de la narration de Dométian, prouvent au contraire l’impartialité avec laquelle il consignait les faits contemporains. Les croisés, alors maîtres de Jérusalem, étaient tout-puissants en Orient et les princes de la dynastie de Némania, préoccupés du soin de consolider les intérêts matériels de leur royaume naissant, cherchaient un appui tantôt à Rome, tantôt à la cour des empereurs grecs.
Comme style, la biographie de saint Sabba par Dométian est contemporaine de celles que nous venons de désigner dans le recueil de M. Safarik, et, par conséquent, elle compte au nombre des chefs-d’œuvre de l’âge d’or de la littérature sacrée chez les Slaves méridionaux. Elle appartient à ce que les slavistes appellent, la catégorie de la rédaction serbe : ce n’est pas précisément la langue des premières versions des Écritures Saintes, mais elle sert de chaînon pour les rattacher aux dialectes modernes, et en même temps facilite l’étude des unes et des autres. J’ignore si je dois avertir les lecteurs français que ma traduction, obligée de suivre servilement le texte en regard, prend souvent des allures embarrassées et sacrifie l’élégance à l’exactitude. Il y a beaucoup de redites et parfois des locutions qui ne sont plus du goût de notre siècle, mais où se reflètent mieux la pensée et l’expression indigènes ; aussi ai-je cru devoir les conserver.
Paris, 15 décembre 1858

DOMETIAN — VIE DE SAINT SAVA
Saint Sabba, premier archevêque de Serbie, éclaireur de l’armée du Christ, et grand thaumaturge, était fils du Grand-Kniaze Némania, souverain autocrate de Dioclétie, de Dalmatie, de Travonie, de Bosnie, de Racie et de tous les peuples d’origine serbe, et ceux qui habitent l’Illyrie, convertis autrefois au christianisme et baptisés par l’apôtre saint Paul. Né et élevé sous les auspices de cette religion, le très pieux prince Némania, doué des dons de la sagesse et de la connaissance du vrai et du bien, pratiquait plusieurs vertus éminentes, mais surtout l’humilité, la miséricorde et la charité. Il avait épousé une princesse, qui lui ressemblait en toutes ces augustes qualités, Anne fille de Romanus, empereur grec. De cette union naquirent des fils et des filles qui, purifiés par le saint baptême, éclairés par le feu sacré de la foi, et fortifiés par l’instruction, faisaient la joie de leur père : tous ensemble jouissaient en paix des bienfaits de la Providence. Cependant, plusieurs années s’étant écoulées sans que la tzarine Anne eût enfanté, son mari et elle en étaient fort chagrins, vu qu’ils désiraient beaucoup avoir encore un enfant mâle. À cet effet, ils priaient nuit et jour, et les larmes aux yeux ils suppliaient Dieu en ces termes : « Maître suprême, Dieu tout puissant ! Toi qui jadis exauças Abraham et Sarah, et les autres Justes qui te demandaient de leur accorder des descendants ; dans ta clémence, Seigneur, daigne nous envoyer aussi un enfant ! Fais qu’après avoir imposé nos mains sur lui, et avoir invoqué ta divine bénédiction, nous puissions avoir en lui notre héritier, l’héritier des royaumes dont tu nous as gratifiés ! Donne-nous-le, et à compter du moment de la conception de l’enfant, jusqu’à la fin de notre vie, nous te promettons, ô notre Dieu, de vivre séparément et dans une chasteté parfaite ! »
Le Seigneur, qui est toujours près de ceux qui l’invoquent, agréa le vœu en leur accordant le fruit de nature : la tzarine accoucha heureusement d’un garçon (en 1169). Ils s’en réjouirent beaucoup, et, pénétrés de reconnaissance, ils glorifiaient Dieu pour avoir daigné exaucer leurs prières. Cet enfant tant désiré, au moment d’être régénéré par le saint baptême, reçut le nom de Rastko, [du verbe rasti, croître, grandir] afin qu’il pût grandir dans le bien du Seigneur. Lorsqu’il fut sevré, ses parents le confièrent aux soins des savants pour lui apprendre à lire dans les livres sacrés. Il y réussit à merveille, car c’était un enfant d’une perception rapide, naturellement gai, d’une figure charmante, aimé de tout le monde et adoré de ses parents. Rien qu’à le voir, on se sentait l’âme réjouie, et l’on se disait l’un à l’autre : certes, ce sera l’homme le plus éminent de son pays. À l’âge de quatorze ans, son père lui donna à gouverner une province de l’empire, et attacha à son service des hommes capables non seulement de lui faire apprendre les choses indispensables à tout homme qui doit régner un jour, mais aussi la morale, l’amour du vrai et la miséricorde. Grâce à ces maîtres habiles, Rastko, éclairé par le Saint-Esprit, reconnut que le commencement de la vraie sagesse, c’est la crainte de Dieu. Il évitait tous ces divertissements désordonnés qui énervent l’âme et le corps, ne recherchant que Dieu, son but unique ; il y faisait converger toutes ses pensées, soit qu’il assistât aux prières dans des sanctuaires, avec tous les sentiments de dévotion, de crainte de Dieu et d’humilité, soit qu’il méditât les merveilles de la commisération du Fils de Dieu envers les hommes, soit enfin qu’il voulût y conformer sa vie, absorbée dans la contemplation de la mort, du jugement dernier, de l’enfer et du royaume céleste, Rastko méprisait toutes les jouissances de ce monde. Lorsqu’il eut atteint sa dix-huitième année, ses parents se proposèrent de le marier. Par hasard, on plutôt par un effet de la Providence divine, cela coïncida avec l’arrivée d’une mission de vénérables moines du mont Athos, envoyés à la cour de son père, pour y rechercher l’aumône. Le jeune prince s’en réjouit vivement, car il affectionnait le saint état monastique. Il ne tarda pas à apprendre que parmi les envoyés il y avait un prêtre, russien d’origine et très versé dans les matières de la vocation religieuse et de la vie de privations. Rastko, se ménage une entrevue avec lui, et là, sans témoins, il lui demande des renseignements sur les anachorètes du saint mont Athos et le mode de vivre des dévots qui l’habitent. Puis, il lui dévoile ses pensées les plus intimes ainsi que son projet de s’enfuir avec eux, en priant le prêtre de ne point en parler à qui que ce fût et de garder soigneusement le secret. Au récit que le prêtre lui fit de toutes les particularités de la règle, comme quoi les saints pères y vivaient dévotement, ou enfermés dans des monastères, en commun avec d’autres frères, ou isolés un à un, ou bien deux à deux et trois à trois, et comme quoi ils s’exaltaient à force de prières et de jeûnes ; Rastko, émerveillé et attendri, fondit en larmes, en s’adressant ainsi à son interlocuteur : « Père, je m’aperçois, pauvre pécheur que je suis, que Dieu, qui sait tout, vous envoya ici pour calmer les angoisses de mon cœur. Oui, ce n’est que maintenant, l’âme ravie de joie, que je commence à me comprendre moi-même et à m’expliquer ce que je désirais si ardemment ! Heureux en vérité, trois fois heureux ceux qui se sont assuré une existence si tranquille. Dites-moi, vénérable père, que dois-je faire pour briser à tout jamais avec cette vie mondaine et orageuse, pour vivre à l’instar de vos saints pères ? Maintenant si mes parents me contraignent de me marier, il me sera plus difficile encore de rompre tous ces liens de la terre qui me retiennent ici où je ne voudrais pas rester un jour de plus, de crainte que l’esprit du mal ne me fasse changer d’idée et de résolution. Je partirais tout seul pour Athos, mais je ne connais pas la route qui y conduit. Ah ! si je m’égare et si les émissaires de mon père m’atteignent ! Il est tout-puissant. Il me ferait revenir sur mes pas, et alors plus d’espérance ! Je lui aurais causé inutilement du chagrin, et moi-même je me serais couvert de honte avant d’avoir réussi dans l’œuvre de Dieu ». Le vieillard, qui écoutait attentivement, répondit : « Enfant chéri de Dieu, l’amour des parents est certes une chose désirable et les liens de la nature doivent être respectés. Cependant Notre-Seigneur Jésus-Christ recommande de les abandonner pour le suivre dans le royaume du ciel. » Rastko, semblable à un sol fertile, recevait dans son cœur chacune des paroles du vieillard, en les arrosant avec des larmes de joie. Le prêtre étonné admirait la puissance de l’amour dont le jeune prince brûlait pour la cause de Dieu, et il dit : « Mon fils, je vois ton âme plongée dans les profondeurs de l’amour divin ; hâte-toi de réaliser tes projets, qui ne manqueront pas de te profiter aussi bien qu’aux tiens. Pendant le voyage, je t’accompagnerai moi-même pour te soigner et te conduire jusqu’au mont Athos. Espérons en Dieu ; seulement, pourvois-toi d’un bon cheval de course, et partons d’ici au plus tôt ». À ces paroles, le jeune homme, plein de joie, ayant adressé une prière de reconnaissance au ciel, remercia aussi le vieillard : « Dieu te bénisse, ô saint père, dit-il, de m’avoir fortifié l’âme ! ».
Il va trouver ses parents, et les prie de le bénir, sous le prétexte de vouloir prendre part à une chasse aux bêtes fauves, dont on organisait la battue dans les montagnes voisines du château. Que Dieu et sa bénédiction, disent-ils, soient avec toi, cher fils ; qu’il te défende et qu’il aplanisse le chemin sous tes pas. Pour mieux rassurer ses parents, Rastko fait aussitôt envoyer dans la montagne son équipage de vénerie, avec l’ordre d’y préparer la battue. Il sort du château avec ses gentilshommes, en déclarant que le lieu du rendez-vous général est au pied de telle et telle montagne. En effet ils y arrivent, et après s’être divertis en sa compagnie jusqu’au soir, ils s’endorment d’un sommeil profond. Alors Rastko court rejoindre son moine affidé et ils partent secrètement. Les voyageurs poursuivaient leur course, accélérée pendant toute la nuit, et ils étaient déjà bien loin au moment où les premières lueurs de la matinée commencèrent à poindre. Lorsque le jour eut éclairé l’horizon, les nobles seigneurs se rendirent au camp du tzarévitch [Titre honorifique qui signifie « fils du tzar, » et en même temps, « héritier de sa couronne. »] pour saluer leur maître, et ne l’ayant pas trouvé, ils disent : voilà le vilain tour qu’il nous a joué, parce que nous avons dormi plus longtemps que lui ! Dès le grand matin, il sera retourné à la maison de son père. Cependant attristés et ne sachant pas comment agir, ils firent beaucoup de recherches dans la montagne sans pouvoir le trouver. Alors, abandonnant la chasse, ils se rendent chez ses parents, et ils déclarent ignorer ce qu’est devenu leur fils. Ceux-ci à la réception de cette triste nouvelle concernant Rastko, frappés de consternation et d’une immense douleur, tombent instantanément par terre, semblables à des corps inanimés. C’est à grand-peine qu’étant aspergés d’eau froide, on put les faire revenir à la vie. La nouvelle de ce fait étrange s’étant répandue parmi les seigneurs et les nobles de l’empire, ils accouraient de tous côtés et il y eut beaucoup de larmes et de gémissements. Après l’explosion des premières impressions d’affliction et de douleur, l’autocrate revenu à lui-même intima à tous l’ordre de cesser de pleurer. Il commença par rendre des actions de grâces à Dieu, et ensuite il dit à tous ceux qui l’entouraient, de même qu’à son épouse chérie, la mère du jeune prince : « Du courage, amis, nous n’avons pas de motifs pour continuer à nous affliger trop. Mon fils ne périra point. Dieu qui nous l’avait donné quand nous n’avions plus d’espoir, daignera encore une fois me permettre de le voir et de me repaître de la vue de ses traits chéris ». Aussitôt il fait venir un de ses chefs en lui disant : « Ami, tu connais la douleur d’un père et l’ardeur qui consume les entrailles des parents, et le feu inextinguible qui brûle dans leur cœur ; saisis donc, mon cher, cette occasion de nous prouver ta fidélité et ton amour. Si tu atteins et ramènes mon fils, tu auras arraché la mère à une mort certaine et soulagé mon cœur paternel ; en même temps tu auras mérité de notre part toutes espèces de distinctions et de faveurs. » Après quoi, il appelle auprès de lui plusieurs jeunes seigneurs, et les ayant excités par de semblables promesses, il les fait monter sur des chevaux vigoureux et leur ordonne de se rendre jusque dans les réduits les plus reculés du mont Athos. Pour autoriser leur démarche, il leur remet une lettre confidentielle adressée à l’éparque de Salone en lui enjoignant d’user de la force dans le cas où le prince ne voudrait pas obéir, et de le livrer au voïvode les poings liés. Il ajoute aussi cette menace que : « si l’éparque se refuse à l’accomplissement de mes ordres, qu’il sache qu’il s’attirera la haine et les châtiments au lieu de l’affection dont l’autocrate l’honorait jusqu’alors. »
Le chef de l’expédition ayant reçu ces ordres et cette lettre, comme un dépôt du plus grand prix confié à ses soins, se met en route avec les jeunes seigneurs, et chevauchant nuit et jour, ils arrivent en toute hâte sans encombre dans la ville de Salone. Reçus avec honneur par l’éparque du lieu, ils lui remettent leur lettre, et lui racontent combien est grande l’affliction de leur souverain à cause de l’absence de son fils. L’éparque, qui aimait beaucoup le grand kniaze Etienne Némania, se fit rendre un compte exact de l’événement et en fut péniblement affecté. Avec des témoignages de respect et d’amitié envers le voïvode et ses jeunes et nobles conseillers, il leur accorda d’honorables gardes pour les conduire directement chez le Prote, c’est-à-dire le chef supérieur de tous les couvents du mont Athos, auquel il avait écrit un message ainsi conçu : « Considérant qu’il s’agit d’une affaire importante, relative au fils du grand kniaze Etienne Némania, je prie ardemment Votre Éminence, de ne point dédaigner notre demande. Au contraire, si le fils de ce souverain de Serbie vient chez vous, faites-en sorte qu’il retourne aussitôt chez ses parents. N’encouragez pas ceux d’entre les moines qui croiraient devoir favoriser sa retraite, car en agissant ainsi nous pourrions irriter non seulement les ambassadeurs de Serbie, mais encore beaucoup d’autres. Tous sont prêts à verser leur sang pour leur tzar et à lui sacrifier leurs têtes. Gare à vous, car cette nation valeureuse ne nous laisserait pas en paix en Thessalie ni vous au mont Athos. »
L’ambassade, pendant son voyage dans l’intérieur de la montagne sainte, et après avoir franchi la barrière, s’enquérait près de tous ceux qu’elle rencontrait, leur décrivant la taille élancée du jeune prince, sa belle figure et autres particularités de son extérieur. On répondit : « Peu de temps avant votre arrivée, celui que vous cherchez s’est renfermé dans le monastère russien de saint Pantaléon, et y demeure depuis. » À cette nouvelle, les officiers de l’ambassade quittent le chemin qui les conduisait chez le Prote, et se rendent au plus vite dans le monastère désigné. Ils y entrent inopinément et y trouvent celui qu’ils recherchent, ce qui les réjouit au point que, dans l’enivrement de leur joie, ils oublièrent le malaise et les fatigues d’un si lointain et si rapide voyage. Après avoir pris du repos, ils se demandèrent l’un à l’autre comment ils devraient s’y prendre pour le ramener à la maison paternelle. Ils furent d’abord d’avis de lui mettre les menottes, mais le cœur leur manqua, et ils eurent honte de porter la main sur leur maître ! Ils usèrent donc le moins possible de violence, se contentant de disposer des sentinelles, de manière qu’il fût sévèrement gardé à vue. En même temps ils firent reposer hommes et chevaux, pour pouvoir regagner leurs foyers au premier signal.
Le jeune prince observait tout cela : il était frappé de preuves de l’amour ardent que ses parents avaient pour lui et du zèle qui leur inspira l’idée d’envoyer dans un pays étranger le plus haut magistrat, choisi parmi les voïvodes de la Serbie. Il en était si humilié qu’il n’osait lever les yeux vers le voïvode. Enfin il le prend en tête à tête et le conjure avec instances de le laisser continuer l’œuvre qu’il s’est proposée et pour laquelle il avait déjà quitté ses parents, méprisé tout, ne voulant plaire qu’à Dieu. Le voïvode lui répondit en peu de mots : « Si, lorsque nous t’avons découvert, toi notre Seigneur, nous t’eussions trouvé ayant déjà embrassé l’état monastique, nous eussions eu tous deux un prétexte pour ne pas agir et différer l’exécution de mes instructions ; mais puisque, par la volonté de Dieu, nous te voyons tel encore que tes parents le désirent, comment pourrais-je éluder leurs ordres ? C’est pourquoi je t’en supplie, mon Seigneur, de n’y plus penser. Viens avec nous, tes esclaves, content et heureux de pouvoir calmer la douleur de tes parents. Il n’y a que ton retour chez eux qui, comme un baume salutaire, pourra cicatriser les blessures de leurs cœurs. Je dois pourtant déclarer que, dans le cas où tu serais d’un avis contraire, et ne voudrais retourner de bon gré avec nous, j’ai reçu l’ordre de te charger de chaînes et de t’y conduire par force. »
Le tzarévitch ayant entendu cette menace et voyant le voïvode inébranlable dans sa fidélité à son souverain, fait rayonner sa figure des sentiments de joie qu’il éprouve. Il serre dans ses bras le voïvode, en ami, et lui prodiguant des caresses et des baisers, il s’écrie : « Réjouis-toi, mon ami ! l’esprit et la raison de la jeunesse changent souvent. Dans leurs rêves creux, ils présument qu’ayant une fois posé le pied sur le premier degré de l’échelle de la vraie piété, ils ont déjà atteint le ciel. C’est ainsi que moi-même, je m’imaginais pouvoir tout d’emblée quitter les festins royaux et les douceurs de l’éducation princière, pour hanter le palais des cieux et y jouir de la paix des bienheureux. Maintenant, mieux avisé, je sais ce que c’est que la vie monacale ; de combien et de quels jeûnes n’a-t-elle pas besoin pour être parfaite ! J’hésitais entre le désir de revenir sur mes pas et la honte de ne pouvoir pat m’y résoudre ; eh bien, je te remercie plus encore que mon père, d’avoir pris la peine de me contraindre au retour et, par ce moyen, me délivrer de la honte de reparaître dans la maison paternelle ! » Tandis que ses lèvres proféraient ces paroles en présence du voïvode, sa pensée se portait secrètement ailleurs. Soupirant vers Dieu qu’il invoquait, il le priait de lui venir en aide dans l’accomplissement de ses désirs : car il combine une œuvre de pieuse ruse, inspirée par la sagesse de son cœur ; et éclairé par les lumières du Saint-Esprit, il se propose de surpasser le voïvode en adresse. À cet effet, il supplie l’higoumène de leur faire préparer un festin somptueux, comme s’il voulait se réjouir avec le voïvode et ses nobles et ne les laisser retourner chez eux que le lendemain. Le jeune prince communique son projet à l’higoumène, et il le prie d’ordonner aux moines du monastère de commencer le soir même à chanter les matines.
Sur ces entrefaites, les dispositions nécessaires ayant été prises, les convives s’assoient à une table somptueuse, pourvue de tout ce que le faste avait de plus digne d’être offert à ces hauts dignitaires. Le jeune prince les sert de ses propres mains et, leur versant du vin, il égaie ses illustres hôtes par des joyeusetés. Le souper s’étant prolongé bien avant dans la nuit, l’higoumène ordonna de faire résonner le maillet du monastère, car c’était un jour férié ; puis, s’étant levé, il se rendit avec le jeune prince à l’église, pour assister aux prières. Ils furent suivis par le voïvode ainsi que par tous ceux qui se trouvaient présents. Les chants et les lectures se prolongeant plus que de coutume, les assistants, y compris les nobles préposés à la garde du prince et le voïvode, par suite soit des fatigues du voyage, soit des amples libations du festin, succombèrent au poids du sommeil et s’endormirent.

Le jeune prince avec son regard pénétrant s’aperçut aussitôt de l’état où se trouvaient ses gardiens, qui ronflaient à qui mieux mieux. Il se lève, et, après avoir salué le saint autel, déclara qu’il voulait accomplir les vœux faits au Seigneur. Aussitôt qu’il eut reçu la bénédiction de l’higoumène, il choisit un moine dans le nombre des pères revêtus du sacerdoce. Tous deux étant montés sur une colonne qui se trouvait dans l’enceinte du monastère, et où il y avait une chapelle sous l’invocation du prophète saint Jean, précurseur du Christ, le très orthodoxe tzarévitch s’y enferma et s’écria d’une voix ravie de bonheur : « Maintenant je te remercie, ô Dieu., inépuisable dans tes libéralités ! Désormais je t’exalterai, ô bonté suprême, comme tu m’as élevé ! … » De son côté le moine, ayant prié, lui coupa les cheveux ; il le revêtit de la dalmatique si ardemment désirée, et changea son nom de Rastko en celui de Sabba. Le jeune homme, heureux de son nouvel état, remerciait beaucoup le Créateur du bienfait qu’il avait daigné lui accorder en accomplissant le désir de son cœur pacifique. Le vieillard admirait l’émotion et l’attendrissement du néophyte.
Pendant ce temps, les lectures se terminèrent, tous les fidèles se retirèrent. Alors les guerriers qui gardaient le prince s’éveillent en sursaut et le cherchent, sans pouvoir le trouver ni à l’église ni dans le monastère, grâce à sa métamorphose ; dépités et furieux, ils se mutinent. Le sang des soldats bout dans leurs veines. Ils commencent par s’en prendre à l’higoumène. Celui-ci ne pouvant donner aucune réponse satisfaisante, ils se ruent sur les prêtres et les accablent de coups. Ce ne fut qu’avec la plus grande peine que le voïvode parvint à apaiser l’émeute ; après quoi, il dit à l’higoumène :
« Quelle est cette perfidie que vous venez de commettre, ô pères révérends ? Quel mêlait nous a valu une pareille insulte ? Comment avons-nous mérité le tour indigne que vous venez de nous jouer ? Tout en respectant l’ange dont vous êtes l’image, nous méprisons votre malice diabolique. Nous avons été respectueux et bienveillants envers vous, nous vous avons traités avec autant de magnanimité que de cordialité. N’est-ce pas de votre part qu’est venu en Serbie ce fripon digne de mort (en montrant au doigt un des moines) ? Il commença par nous demander l’aumône, et ensuite il outragea le tzar qui vous a comblés de dons. Il suborna le fils dans les bras de son père et s’enfuit avec lui. Par cet instrument de votre insatiable perfidie, vous avez flétri ses parents, vous les avez abreuvés de mortelles larmes, et en même temps vous nous avez exposés à des peines affreuses inutilement endurées. Ici même et sous nos mains, après avoir perfidement soustrait notre maître, vous proposez-vous de le retenir plus longtemps encore dans les filets de vos infâmes intrigues ? Dans votre égoïsme présomptueux et votre sainteté supposée, présumez-vous être au-dessus de toutes les lois et en dehors de l’accomplissement des devoirs humains ? N’est-ce pas vous qui, vous abritant derrière la sainteté et l’innocence inhérentes à l’état sacerdotal, pensez pouvoir impunément commettre toutes les abominations ? Qu’y a-t-il donc de sacré pour vous, si vous osez même tromper votre propre tzar si impudemment ? Où pensez-vous aboutir par toutes ces machinations effrontées ? Est-ce une insulte ou un défi jeté à la face de votre souverain ? Ou bien prétendez-vous que nous nous résignerons à subir tant de fatigues en pure perte, et que nous frapperons l’air, sans trouver notre maître pour l’emmener avec nous ? Non, nous vous l’arracherons lors même que vous persisteriez à nous cacher où il languit. Sachez que votre vie à tous est en notre pouvoir ! Voici ce qui vous donnera la mort ! Avec le tranchant de ce glaive, je faucherai vos têtes ! Ce fer saura bien affranchir le prince de votre violence arbitraire, et réduire à néant votre hypocrisie ! »

Les guerriers qui, debout autour de leur chef et les yeux fixés sur lui, n’attendaient que le signal pour agir, recueillent ces paroles du brave voïvode. Ils s’enflamment de colère, tombent en fureur sur les moines, et recommencent à les frapper cruellement, cherchant leur jeune maître… Au bruit de l’émeute, qui grondait terrible comme un orage, et aux cris plaintifs des saints Pères, battus sans pitié, le tzarévitch, caché dans sa colonne, fut ému. Il entendit leurs gémissements qui retentissaient tristement au fond de sa retraite, et il craignit que l’ardeur de la vengeance, embrasant de plus en plus les guerriers avides de sang, n’aboutît au meurtre. Aussi se penche-t-il du haut de sa colonne et d’une voix courroucée apostrophe le voïvode : « Me voici ! je suis celui que vous cherchez ; mais, toi, qui es soi-disant sage, n’agis-tu pas avec l’irréflexion d’un enfant ? À la tête d’une poignée d’hommes et dans un pays étranger, oses-tu tenir des propos hautains et insensés ? » S’adressant aux nobles il ajouta : « Tous ne craignez pas Dieu puisque vous ne respectez pas ses sacrés représentants ! Est-ce beau, est-ce glorieux de vous armer ainsi contre les élus du Seigneur, de maltraiter les moines inoffensifs et de les faire trembler ? Quel mal vous ont fait ces pauvres du Christ ? N’avez-vous pas honte de dégainer et de vous ruer sur eux ? Je reste ici, mais je n’ai pas le loisir de vous entretenir plus longtemps. Vous ne me verrez que demain. » Le voïvode et sa suite, ayant entendu ces paroles de la bouche du tzarévitch, se sentirent découragés et honteux. Ils ne savaient que lui répondre : seulement, s’étant rapprochés de la colonne, ils l’entourèrent et gardèrent toute la nuit. Le lendemain, en plein jour, le vénérable Sabba, se penchant du haut de la galerie, appela le voïvode et ses nobles compagnons et parut devant eux dans sa mise de moine. Le voyant, dans cet état, frappés d’épouvante et comme privés de parole, ils tombent tous le visage contre terre, l’arrosant de larmes amères. Ils y demeurèrent longtemps plongés dans les perplexités et le désespoir, tandis que le prince-moine chantait l’hymne du Seigneur, en leur disant : « Ô, mon âme, glorifie le Seigneur, qui m’a revêtu du vêtement de sa miséricorde ! » Les guerriers sanglotants relèvent enfin la tête, et regardent le voïvode qui, d’une voix forte et accentuée, s’écrie :
« Enfant, au cœur d’une cruauté inouïe ! Prince, pourquoi nous précipitez-vous dans l’abîme de perdition et de honte à l’égard de notre souverain votre père ? Comment pouvez-vous mépriser une tendresse et une sollicitude semblables à celles que vous témoignent vos parents, le tzar et la tsarine, qui vous chérissent comme leur fils unique, plus que la prunelle de leurs yeux, et vous préfèrent à la couronne impériale et même à leur vie ! Vous, l’espoir et la joie d’un peuple tout entier qui attend votre règne, comment avez-vous pu, séduit par un vil moine, ouvrir votre cœur de prince à ces billevesées de couvent, que l’on vous a traîtreusement insinuées, et que vous avez préférées à l’amour paternel ? Ce bonheur imaginaire, que procure la solitude, peut-il vous être plus cher que le bien-être de millions d’hommes qui espèrent en vous l’héritier de leur tzar et leur futur souverain ? Ne savez-vous donc pas, Kniaze sans pitié, qu’à la réception de la nouvelle de votre déraisonnable erreur, le cœur de vos parents se brisera de chagrin et la joie de vos sujets sera changée en tristesse et en stupéfaction ? En présence de toutes ces considérations, comment pouvez-vous jouir de l’accomplissement de vos rêves, sans ressentir à tout moment les angoisses d’une âme bourrelée par de cruels remords ? Ne crains-tu donc pas que ton père, outragé d’une manière si éhontée, ne vienne ici venger l’insulte, et t’arracher de cette colonne après avoir écrasé tes suborneurs sous le poids de la toute-puissante main de son peuple, qui brûle du désir de se venger ? Ah ! que ne puis-je voir ici mon souverain, et sur un geste de lui, mon bras saurait bien venger le grand tzar de la sordide avidité de vos intrigants du monastère. »

Le tzarévitch frissonna de peur à la vue de l’extrême irritation de tous les guerriers, et redoutant la probabilité d’une nouvelle attaque de leur part, il essaya de les calmer par des paroles affectueuses. Il leur dit, entre autres :
« Ô mes frères et amis ! je vous conjure de ne pas vous affliger sur mon sort. Remercions plutôt Dieu de la faveur qu’il vient de m’octroyer. Il m’a sauvé à deux reprises, d’abord en me permettant d’accomplir mon évasion sain et sauf, et puis en m’arrachant ici de vos mains. Vous voulez me faire échouer dans la poursuite d’un but méritoire et que je convoite ardemment. Vous désirez vous glorifier devant votre souverain de m’avoir fait revenir sur mes pas. Mais ce Dieu sur lequel j’ai, compté, en fuyant la maison paternelle, fut mon aide et mon sauveur. Selon sa volonté suprême et sainte, il continuera de pourvoir à mes besoins. Quant au gouvernement et au bien-être auxquels la nation, me dites-vous, s’attend de ma part, ô, mes amis, j’aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Élevé à la cour et sur le sein de mon père, j’eus maintes occasions d’assister à son action gouvernementale. J’ai vu quelles immenses quantités de devoirs doit remplir le souverain à chaque heure du jour. Quelles entraves et quels lourds fardeaux ne rencontre-t-il pas sur son chemin ? Les premiers d’entre ses serviteurs n’hésitent pas à lui dissimuler habilement la vérité. Le bonheur de tant de milliers d’hommes relevant du tzar, que répondra-t-il devant Dieu s’il a négligé un seul des devoirs de souverain ? C’est par une sagesse surhumaine, un amour ardent pour le prochain, un travail assidu, et à force de veilles et de labeurs, de jour et de nuit, qu’on y réussit. Le tzar qui aime ses sujets comme ses enfants et remplit convenablement ses devoirs doit ou être partout, voir tout, et tout entendre par lui-même, ou avoir plusieurs serviteurs qui, en amis zélés et dévoués, n’aient devant les yeux que le bonheur de tous. Or, comme il est très souvent presque impossible de pourvoir à l’un et à l’autre, il ne reste au prince qu’à opter entre les deux extrémités, ou ne pas s’inquiéter de la prospérité de ses peuples, ou se résoudre à mener cette vie d’au jour le jour, à travers d’incessantes sollicitudes, partagée entre le désir et la crainte, l’espoir et la séduction, la colère et l’affaissement. Quant à moi, avant de consulter mes penchants naturels, j’avais mis à l’épreuve mes forces et mes moyens. Or, j’avoue, que je ne les ai pas trouvés être à même de pouvoir supporter le poids immense de la gestion des affaires publiques… Ne croyez pas que j’aie prisé mes aises personnelles au-dessus du bien-être du peuple, ou que d’ignobles sentiments de mépris de l’amour filial et de la tendresse due aux parents m’aient poussé à fuir le monde, les hommes et ma famille, jusqu’au fond de ce désert. Ah ! s’il m’était donné de pouvoir ouvrir mon cœur devant vous, je serais certainement excusable aux yeux de tout le monde et en même temps justifié !… Mais, maintenant c’en est fait ! …. Vos efforts ne sauraient me profiter, non plus que les larmes et les sanglots de mes parents ! Je vous en supplie donc, mes braves amis, cessez vos lamentations. Retournez là où le devoir vous appelle, saluez-y mes chers parents ainsi que mes bien-aimés frères ; qu’ils ne s’affligent plus à cause de moi, qu’ils ne m’en veuillent pas ; je suis toujours de la famille ! — Mais, ô affreuse et foudroyante pensée, qu’ils ne me maudissent pas ! qu’ils viennent plutôt au mont Athos, eux aussi, glorifier le Très-Haut qui a daigné m’accorder la faveur de louer dans ce sanctuaire sa providentielle bonté, et d’atteindre enfin l’objet de tous les vœux de ma plus tendre enfance. Ici j’espère servir d’appui à leur vieillesse, et honorer leurs cheveux blancs… »
En disant cela, il fait quelques pas en avant, la menace au front, le visage inondé de larmes ; puis il tombe par terre et reste là sans proférer aucune parole… Il se relève enfin. Ses yeux, reflétant la rage, la souffrance et la résolution, s’arrêtent sur le groupe des guerriers qui se désespéraient réunis au bas de la colonne. Du fond de son cœur rempli d’amertume, il pousse un soupir, et, leur jetant ses vêtements princiers et des poignées de boucles des cheveux blonds dorés qu’on lui a coupés, il dit : « Prenez ces signes et emportez-les comme autant d’incontestables preuves que vous m’avez trouvé vivant, moi, Sabba de nom, moine de Dieu. » Il y joignit un message préparé d’avance, adressé à ses parents et conçu en ces termes :
« Mes très gracieux et très chers parents, je sais combien vous affligera tout d’abord la nouvelle de ma séparation, que l’on suppose à tort éternelle. J’espère qu’aussitôt que vous aurez appris pourquoi j’ai renoncé aux biens de ce monde, je vous verrai immédiatement venir, Dieu le permettant, visiter la montagne sainte. Ainsi serai-je de nouveau réuni à vous, et réjoui du bonheur de vous contempler, d’honorer votre vénérable et sainte vieillesse, de savourer les délices de la douceur de votre amour paternel, et, j’aime à l’espérer, de voir peu à peu votre douleur diminuer et enfin disparaître. Je vous supplie de ne point vous affliger de mon sort. Ne me croyez pas perdu, mais félicitez-vous plutôt de ce que j’ai échappé à la perdition, et souvenez-vous de moi dans vos prières, afin que, grâces à elles, Dieu daigne me donner la force de parachever ma course ; autrement, vous ne me verrez plus vivant auprès de vous. Chers parents, à votre tour, prenez soin du salut de vos âmes… » Il ajouta quelques réflexions tirées des textes évangéliques, touchant l’humilité, l’amour de la paix, la vérité et le Jugement, finissant ainsi son message : « Ne faites pas aux autres ce qui vous est pénible et ce qui n’est pas désirable pour vous-mêmes. »

Le voïvode et ses nobles compagnons, ayant recueilli les cheveux, les vêtements et reçu le message du tzarévitch, dont la résolution fut implacable et inébranlable, se tournèrent vers lui les yeux pleins de trouble, s’écriant :
« Malheur à nous, infortunés que nous sommes ! Pourquoi faut-il, ô notre Seigneur, qu’en te retrouvant nous soyons plus affligés qu’au jour de ta fuite ? Et vous, dépouilles chéries, vêtements du bien-aimé, objet de tant de regrets, comment vous emporter ? Comment vous faire voir aux parents, aux frères qui demanderont leur fils et leur frère ? O cheveux chéris ! vous qui, jadis, délectiez les yeux et le cœur de la famille, comment nous résoudre de vous les offrir, vous sujet de larmes, du trouble et du désespoir des parents ? Comment les porterons-nous, et quelle récompense nous en reviendra-t-il ? Notre festin de la dernière nuit n’était que dérision au lieu d’une réjouissance. Tu nous as trompés, comme Jacob trompa Ésaü pour hériter de la bénédiction paternelle. La coupe qu’hier encore, ô, Seigneur, tu remplissais d’un vin généreux, était plus douce que le miel et débordait de plaisir ; aujourd’hui elle est remplie de fiel et d’absinthe ! Fatale nuit où, enivrés de plaisirs empoisonnés, nous nous endormîmes ; puisses-tu être éternellement sombre et que jamais tu ne sois embellie par les doux rayons de la lune ! Insensés que nous sommes, nous laissons dans un instant s’échapper de nos mains celui que nous avons poursuivi pendant plusieurs jours ! Pourquoi ne l’avoir pas plutôt enchaîné selon les ordres de son père ? Nous ne serions pas en proie à toutes ces angoisses mortelles ! Maintenant que ferons-nous ? Comment paraître devant notre souverain ? Quel roc ou quelle masse de fer ne se briserait pas de douleur et d’épouvante au triste récit que nous devrons faire aux parents et aux frères de notre maître ? »
S’entretenant par de tels et semblables discours, les uns pleuraient, les autres ne respiraient que vengeance, et, à les entendre, les pierres insensibles elles-mêmes se seraient émues. Enfin, accablés de tant de souffrances et de lassitude, ils lui jettent un regard de reproches mêlé de mépris, et disent : Adieu ! cœur de roc, adieu ! fuis le monde pour t’ensevelir dans les ténèbres, car tu es indigne de la lumière ! Après avoir trompé ton père, tu nous as trompés à notre tour. Nous ne comprenons pas comment Dieu t’agréerait, toi au cœur dur et astucieux ? Ces paroles, entrecoupées de larmes de rage et d’attendrissement, furent les dernières qu’ils prononcèrent. Puis ils partirent pour regagner la Serbie. Tout en chevauchant, ils se retournaient vers la colonne pour l’apercevoir, jusqu’à ce qu’elle eût entièrement disparu à leurs yeux. Lorsqu’ils furent éloignés, le saint descend du haut de sa colonne, remercie Dieu d’abord, puis court saluer l’higoumène et tous les frères. Il les conjure tous, mais principalement le vénérable vieillard, l’higoumène, de ne pas lui en vouloir, de la brutalité qu’ils ont soufferte de la part des soldats du voïvode. Au contraire, dit-il, priez Dieu de pardonner à ceux qui vous ont offensés et de les laisser en paix et santé regagner leurs foyers. Les frères, bien accablés de coups, pouvant à peine remuer, vinrent tous l’embrasser, lui montrant leurs plaies, leurs foulures et les tumeurs dont leur corps était bleui. Le sage et pacifique Sabba leur dit : « Frères, pardonnez aux soldats, car ils n’ont su ce qu’ils faisaient. Emportés par la colère, ils vous ont confondus avec leurs ennemis. Souvenez-vous des paroles du Seigneur, qui dit : ‹ Bienheureux si vous êtes calomniés pour mon nom ; on vous chassera et on vous injuriera à cause de moi. Bienheureux ceux qui pleurent et souffrent pour mon nom, car ils seront consolés ; réjouissez-vous et soyez dans la joie, car votre récompense est abondante dans les Cieux. › » L’âme remplie de bonheur, il leur dit encore ceci : « Dieu est notre refuge et notre force, il nous aide dans les chagrins qui nous accablent. Fidèles aux ordres du tzar, ces émissaires voulaient arrêter mon essor vers Dieu et m’arracher d’ici, brisant les liens de cette parenté spirituelle par lesquels je vous suis uni dans le Seigneur. Mais grâce à vos prières et à la lutte que vous avez courageusement soutenue dans vos corps, outragés pour moi, la fureur des assaillants s’est vue impuissante contre vous. » Les moines, ses frères, si cruellement maltraités et encore gémissants de la douleur causée par leurs récentes blessures, trouvent un soulagement instantané dans ces sages et pacifiques paroles. Heureux d’avoir souffert pour le tzarévitch, dont les consolations leur profitèrent si bien, ils oublièrent vite leurs ressentiments et leurs meurtrissures.
VIE DES SAINTS APÔTRES SERBES SYMÉON & SABBA. RÉDIGÉES PAR DOMÉTIAN MOINE-PRÊTRE DE KHILANDAR AU MONT-ATHOS ET DISCIPLE DE SAINT SABBA PREMIER ARCHEVÊQUE DE SERBIE. ABRÉGÉES ET ÉPURÉES PAR CYRILLE GIVKOVICH, ÉVÊQUE ORTHODOXE DE PAKRATCH ET DE SLAVONIE, CALLET, PARIS, 1858.
SOURCES : 1 , 2 , 3





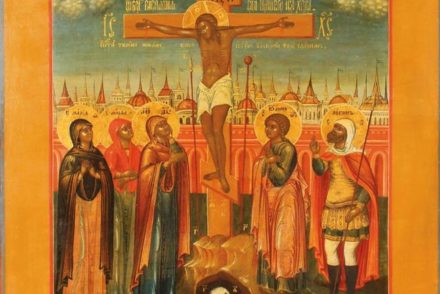
Pas de commentaire